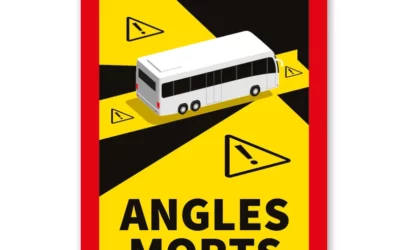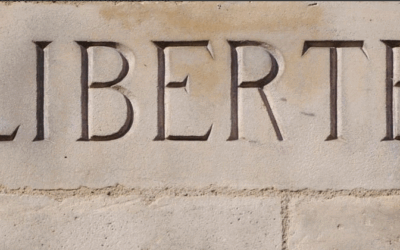1. Le doute, une composante structurelle du rôle de Source
Il existe, autour du rôle de Source, une attente implicite de clarté. Comme si la personne qui porte la vision d’un projet devait naturellement savoir où aller, comment trancher, et à quel moment décider. Comme si sa légitimité reposait sur sa capacité à éclairer la route sans trembler.
Cette représentation, profondément ancrée dans les imaginaires collectifs, ne correspond pas à mon expérience. Ni dans ma position de Source au sein de Sémawé, ni dans les accompagnements que je propose à celles et ceux qui tiennent une place d’initiative ou de responsabilité fondatrice dans leurs projets.
La Source ne sait pas. Ou plutôt : elle ne sait pas d’avance. Elle ne décide pas par calcul, ni par habitude, ni en appliquant une procédure. Elle avance dans un champ d’incertitude, en écoutant ce qui cherche à émerger. Et pour cela, elle doute. Constamment.
Non pas d’un doute paralysant, qui empêche de poser un acte, mais d’un doute structurant, fécond, qui oblige à ralentir, à ressentir, à interroger. Un doute qui maintient la posture ouverte, et protège du glissement vers la toute-puissance ou le repli. Un doute qui oblige à la qualité de présence.
Pensez à cette pensée de Friedrich Nietzsche qui m’a tant guidé dans ma vie : “Ce n’est pas le doute qui rend fou, ce sont les certitudes !”
Avec le temps, j’ai appris que ce doute n’était pas un problème à résoudre, mais une donnée à intégrer, un terrain exigeant, mais précieux. Et j’ai compris que le discernement n’était pas une faculté innée — il s’apprend, il s’exerce, il se muscle, encore faut-il créer l’espace nécessaire pour cela.
C’est la raison pour laquelle j’ai institué, dans mon rythme personnel comme dans mon rôle professionnel, ce que j’appelle des temps de Source : des plages de retrait, de silence, d’écriture ou de relecture, qui permettent de retrouver le fil intérieur, celui qui précède la décision. Sans ces espaces, la perception s’émousse, les repères se brouillent, et les choix deviennent mécaniques.
C’est dans cette disponibilité, et dans cette lenteur parfois inconfortable, que le discernement devient possible.
2. Le discernement, un art à cultiver
Discerner ne relève ni de l’instinct ni de la méthode. C’est un art exigeant, que l’on apprend, affine, reprend sans cesse. Un processus à la fois intérieur et incarné, que j’ai appris à cultiver avec le temps, et que je continue de considérer comme un travail jamais terminé.
Le discernement commence par une qualité de présence à soi. Une capacité à prêter attention aux mouvements les plus fins qui nous traversent : une tension soudaine, une résonance inattendue, une intuition fugace, un désaccord vague mais persistant. Rien de spectaculaire. Le discernement ne crie pas, il murmure !
Encore faut-il lui offrir un terrain propice. Dans un quotidien saturé de signaux, de notifications, de responsabilités fragmentées, l’écoute de soi ne se décrète pas. Elle se rend possible, c’est la raison pour laquelle je parle souvent de temps de Source : ces espaces intentionnels, retirés de l’urgence, dans lesquels je peux m’asseoir, relire, ressentir, laisser émerger ce que je ne perçois pas lorsque je suis pris dans le rythme.
Ces temps-là ne sont pas des moments de réflexion analytique, encore moins de productivité. Ils relèvent d’une posture d’attention calme, d’un retrait fécond, dans lequel je peux reconnaître plus clairement ce qui est vivant, ce qui résiste, ce qui appelle ou ce qui s’éloigne.
Le discernement n’est donc pas une compétence parmi d’autres à activer dans les moments critiques. C’est une attitude de fond, une manière d’être au monde et à soi, qui se travaille dans la durée, souvent à partir de petites choses. Ce sont des ajustements minuscules, presque invisibles, qui créent des écarts significatifs dans la trajectoire d’un projet ou dans la qualité d’une décision.
À force de cultiver cette posture, j’en suis venu à penser que les décisions justes ne se “prennent” pas, elles se laissent percevoir. Elles ne se construisent pas à coup d’arguments, elles se révèlent quand je ralentis dans l’urgence !
3. Le discernement ignatien : écouter ce qui fait grandir la vie
Parmi les approches qui ont nourri ma manière de discerner, comme Source, comme accompagnant, comme homme, l’héritage d’Ignace de Loyola – prêtre Espagnol, à la tête des Jésuites, fondateur de l’une des principales sources d’introspection et de discernement vocationnel dans le catholicisme – est celui qui m’a offert le plus de profondeur, et paradoxalement, le plus de simplicité.
Les mouvements intérieurs : consolation et désolation
Le discernement ignatien n’est pas une technique. C’est une manière d’habiter l’écoute, en prêtant attention aux mouvements subtils de notre vie intérieure :
- La consolation : sentiment de paix, d’élan, d’unification intérieure, d’ouverture à l’autre.
- La désolation : repli sur soi, agitation, vide, lourdeur, confusion, perte de sens.
Mais attention : ces états ne sont pas des récompenses ou des punitions. Ils sont des signaux. Des balises pour percevoir ce qui, au fond de nous, nous met en mouvement vers plus de vie, plus d’amour, plus de vérité.
Plutôt que de chercher à prendre “la bonne décision”, Ignace nous invite à observer :
- qu’est-ce qui en moi ouvre, élargit, unifie ?
- qu’est-ce qui, au contraire, rétrécit, agite, disperse, sépare ou divise ?
Tout commence par l’attention
Le discernement ignatien invite d’abord à observer finement ce qui se passe en soi : les émotions, les pensées, les tensions, les désirs, les résistances… sans les juger, sans les fuir.
Cela suppose des temps de silence, d’examen de conscience, de recul. Ignace propose par exemple un exercice simple et puissant : la “relecture” quotidienne (examen de vie), pour repérer les mouvements de la journée.
Ne jamais prendre une décision en temps de désolation
C’est une règle d’or. Ignace recommande de ne pas agir dans le brouillard intérieur. Il faut attendre que la clarté revienne, ou que l’on puisse se reconnecter à ce qui en nous est stable, ancré, libre. C’est une éthique du rythme, une forme de patience spirituelle.
Chercher le plus grand bien, pas le moindre mal
Contrairement à une logique défensive ou gestionnaire, le discernement ignatien vise toujours le “magis” : ce qui fait croître, ce qui ouvre, ce qui élargit le cœur. Il ne s’agit pas de choisir ce qui coûte le moins, mais ce qui fait le plus de place à la vie.
“Magis” est un mot latin qui signifie “plus”, “davantage” mais dans ce contexte ignatien, il ne s’agit ni de performance, ni d’ambition. Le magis désigne ce qui me fait grandir en profondeur, ce qui me pousse vers plus d’amour, vers une abondance de ce qui nous relie.
L’ultime critère : la paix
Quand une décision est ajustée, même si elle est exigeante ou inconfortable, une paix profonde l’accompagne. Cette paix n’est pas une absence de tension, mais une forme d’unification intérieure : la sensation que je suis aligné avec ce que je dois être.
Une spiritualité du doute fécond
Le discernement ignatien ne supprime pas le doute : il l’habite. Il en fait une matière première pour affiner l’écoute, pour ajuster sa position intérieure. Il est profondément humble : je ne décide pas “à partir de moi”, je décide “en écoutant ce qui me traverse”.
C’est en cela qu’il peut profondément nourrir la posture de Source :
- reconnaître les mouvements qui nous traversent,
- ne pas confondre réactivité et justesse,
- accepter de ne pas savoir tout de suite,
- et apprendre à se laisser guider depuis un lieu plus profond que la volonté ou la stratégie.
4. Le discernement commence par des choses infimes
On attend parfois du discernement qu’il produise des évidences. Qu’il éclaire une décision, tranche une alternative, révèle une direction avec force et netteté. Mais la réalité est souvent beaucoup plus subtile. Les vrais points de bascule ne se signalent pas par un panneau lumineux. Ils se présentent sous la forme d’un frémissement, d’un déplacement intérieur à peine perceptible, d’un écart ténu entre ce que je m’apprêtais à faire et ce qui, soudain, ne sonne plus juste.
Avec le temps, j’ai appris à me méfier des élans trop clairs, trop puissants, trop rapides. Ils sont souvent la marque d’un réflexe, d’une réaction ou d’une habitude déguisée en intuition. Ce que les sciences cognitives appellent le système 1 de notre cerveau, celui de la pensée automatique qui emprunte toujours les mêmes autoroutes.
À l’inverse, les mouvements réellement ajustés sont plus humbles, et parfois silencieux. Ils prennent la forme d’une discrète insistance, d’un retour récurrent, d’un apaisement intérieur sans euphorie. Parfois juste le diaphragme qui descend un peu, le cou qui se relâche, une envie de bailler…
Discerner demande donc une rééducation de l’attention. Il faut désapprendre l’idée que ce qui compte se voit, s’impose, se démontre. Et accepter que la justesse se glisse dans des détails : un ton, un regard, une crispation corporelle, une envie qui s’estompe, un mot qu’on retient, ou au contraire, une parole qu’on ose malgré l’inconfort.
Je me souviens de décisions importantes que j’ai prises — ou différées — non pas parce que j’avais toutes les informations en main, mais parce qu’un détail résistait. Un e-mail que je n’arrivais pas à envoyer. Une fatigue persistante à l’idée de dire “oui”. Ou au contraire, une tranquillité inattendue en envisageant un choix plus exigeant.
Ces signes ne sont pas des preuves et ils ne dispensent pas de réfléchir ni de consulter. Mais ils sont des points d’appui pour sentir ce qui cherche à advenir, et pour différencier ce qui est vivant de ce qui est logique.
Je pourrais définir le discernement comme un art de la nuance, et comme tout art, il suppose un engagement quotidien dans l’invisible.
5. Le discernement comme boussole intérieure du leadership vivant
Dans un monde saturé de méthodes, d’outils et de modèles, il peut sembler fragile, voire naïf, de défendre la lenteur, l’attention, le silence comme conditions nécessaires à l’action juste. Et pourtant, c’est ce que je constate chaque jour : ce n’est pas l’absence d’options qui rend la décision difficile, mais la perte de lien avec ce qui en nous peut discerner.
Pour ceux qui occupent des rôles de responsabilité, ce lien est vital. Il ne s’agit pas seulement de choisir la meilleure option pour l’organisation, mais d’habiter un geste qui soit pleinement assumé, cohérent, intègre. Un acte qui ne nous divise pas, mais qui nous relie. Un choix qui nous permet de rester présents à nous-mêmes, aux autres, et au projet que nous servons.
Le discernement, à ce titre, n’est ni un luxe contemplatif, ni une alternative à la décision. C’est ce qui permet à la décision d’être un acte sincère et humain.
Il suppose un rythme et une écoute intérieure qui se travaille, il suppose de savoir s’interrompre et de ne pas se précipiter pour rassurer, de ne pas trancher pour éviter le trouble.
Il suppose, enfin, une forme de confiance intérieure : non pas dans le fait que je saurai toujours, mais dans le fait que quelque chose en moi — si je l’écoute sincèrement — saura me conduire intuitivement.
Cette confiance se construit en cultivant des temps de retrait, des espaces de relecture, des rendez-vous avec soi-même, que j’appelle des temps de Source.
Ce sont ces espaces qui rendent possible un leadership vivant et robuste : un leadership qui ne s’exerce pas par autorité extérieure, mais par alignement intérieur.

Aliocha Iordanoff
Découvrir d’autres articles de l’auteur !
À lire aussi .
L’Holacratie a-t-elle des angles morts ?
Des lacunes vers la plénitude Un article de Dennis Wittrock publié le 13 juillet 2017 sur Medium, traduit par Aliocha Iordanoff. Les environnements économiques en mutation rapide favorisent l’agilité organisationnelle, rendue possible par une prise de décision...
*En quoi la citoyenneté est au cœur de l’autogouvernance ?
Article original, How Citizenship is at the heart of self-governance écrit par Diederick Janse – 17 mai 2023Traduit par Aliocha Iordanoff - 03 novembre 2025Je pratique passionnément l’auto-gouvernance depuis plus de quinze ans. Je la définis comme le fait de...
*Et si on rendait les entretiens 360° vraiment utiles ?
Chez Sémawé, on aime les processus et les outils… quand ils servent la relation plutôt que de l’abîmer. Et s’il y a bien un outil qui mérite d’être revisité, c’est celui de l’entretien 360°.Trop souvent vécu comme un bilan d’image — parfois cruel, parfois inutile — le...