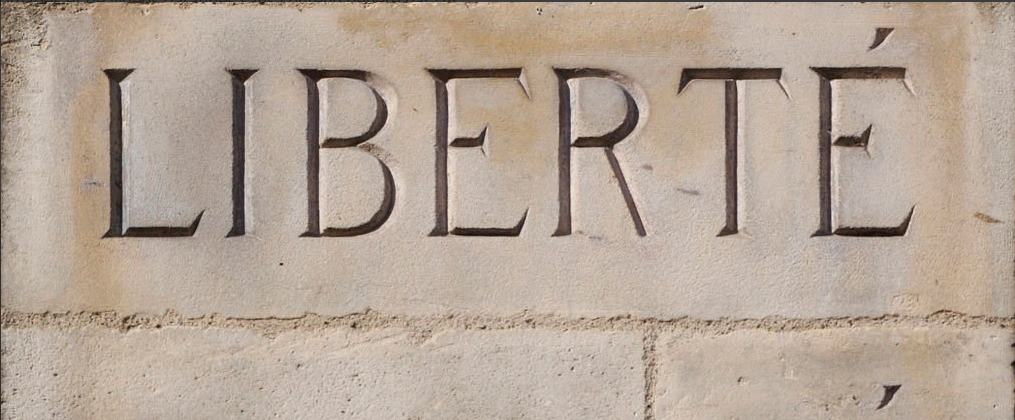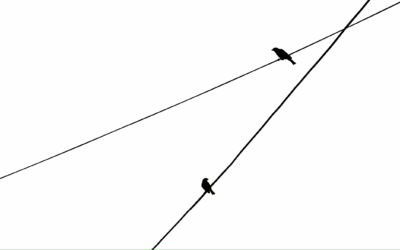Écrit par Diederick Janse – 17 mai 2023
Traduit par Aliocha Iordanoff – 03 novembre 2025
Je pratique passionnément l’auto-gouvernance depuis plus de quinze ans. Je la définis comme le fait de distribuer l’autorité et la responsabilité afin que chacun, dans une communauté ou une organisation, puisse se présenter pleinement au service d’une raison d’être commune.
Mais ces derniers temps, je m’interroge sur le sens de mon travail. De quoi s’agit-il, au fond ? Et quelle est sa pertinence aujourd’hui, compte tenu de l’état de nos systèmes sociaux, économiques et écologiques ?
À quoi sert l’auto-gouvernance ?
Je considérais jusqu’à présent que cette auto-gouvernance avait pour objectif d’accroître l’autonomie, ce qui entraîne de nombreux effets positifs : motivation et créativité accrues, meilleure prise de décision, fidélisation des collaborateurs. L’autonomie est également précieuse en soi, indépendamment des résultats. Pourtant, dernièrement, cela ne me suffit plus.
Nous pensons souvent l’auto-gouvernance et l’autonomie sous l’angle de la liberté négative : la liberté de se libérer de règles arbitraires, de chefs, de bureaucratie, de pratiques managériales obsolètes qui nous laissent impuissants et épuisés.
La liberté négative, à elle seule, est un espace vide, ouvert, non entravé. Mais que faisons-nous de cette liberté ?
À l’inverse, la liberté positive est la liberté de faire quelque chose, pas seulement d’être libéré d’être affranchi de quelque chose. Elle implique de se battre pour quelque chose, plutôt que contre quelque chose. L’absence d’une mauvaise chose n’équivaut pas à la présence d’une bonne chose.
D’où cette question : À quoi sert l’auto-gouvernance ?
Intégrer la citoyenneté au travail
Lorsqu’une personne réalise qu’elle n’est pas impuissante, mais qu’elle fait partie d’une équipe et d’un système, et qu’elle dispose d’une voix qu’elle peut utiliser pour faire part de ses préoccupations, proposer des changements ou lancer des expériences, cela marque un changement important. Cette prise de conscience lui apporte un sentiment d’autonomie et de créativité.
Ce changement peut paraître nouveau, progressiste, voire radical dans le monde professionnel. Mais dans notre « vie privée » — en famille, dans nos communautés — ces comportements sont familiers et courants. La plupart d’entre nous sommes parfaitement capables de prendre des décisions complexes dans la vie et de nous engager activement dans des initiatives communautaires telles que des associations sportives, des initiatives locales, prendre soin d’autrui…
Ensemble, ces comportements indiquent une capacité que nous pourrions appeler « appartenance » : faire partie de quelque chose, avoir un sentiment d’appartenance. Pas seulement de manière passive, comme un sujet ou un consommateur, mais de manière active. Au sens large, nous pourrions appeler cela la citoyenneté. Il ne s’agit pas d’un statut juridique, mais d’une capacité humaine profonde, d’un muscle ou, comme certains le diraient, d’un geste, quelque chose que nous faisons.
La citoyenneté est généralement associée à la partie « vie privée » de la séparation entre vie professionnelle et vie privée. Mais que se passerait-il si nous l’appliquions à la partie « vie professionnelle », à la partie de notre vie que nous passons dans des organisations ?
Nous essayons de donner aux « employés » plus d’autonomie, de voix et d’appropriation. Mais le concept d’employé a été conçu à une autre époque, pour garantir le contrôle, la conformité et l’efficacité. Plutôt que de le pousser à son point de rupture, comme je pense que nous le faisons, tournons-nous vers un concept différent. Introduisons notre citoyenneté au travail.
Citoyenneté dans les organisations et des organisations
La citoyenneté est la volonté et la capacité de participer à une communauté et d’y contribuer. Nous associons généralement ce terme à l’État, au vote et à notre passeport, alors pourquoi l’utiliser de cette nouvelle manière ? Pourquoi ne pas utiliser les termes existants tels que l’engagement des employés, la participation ou le leadership personnel ?
Je pense que la citoyenneté est un concept plus puissant. Elle nous invite à considérer les organisations comme des communautés : celles qui nous façonnent, mais que nous façonnons également, ensemble.
La citoyenneté va au-delà du leadership. Elle concerne l’appartenance. Elle remplace l’individu autonome (comme le « leader » tant vanté) par le récit plus nuancé d’un membre de la communauté. Et dans le meilleur des aspects, la citoyenneté est inclusive. Elle reconnaît que chacun a une voix et un rôle, plutôt que de donner le pouvoir à une élite exclusive.
Appliquer la citoyenneté aux organisations
En zoomant vers l’intérieur, nous voyons la citoyenneté dans les organisations. Comment pouvons-nous nous inviter et nous inciter mutuellement à pratiquer la citoyenneté dans notre vie professionnelle quotidienne ? Et comment pouvons-nous nous organiser pour la citoyenneté, plutôt que contre elle ? De quoi avons-nous besoin pour apporter notre attention, notre créativité et notre intelligence pratique à notre lieu de travail ?
En zoomant vers l’extérieur,nous voyons la citoyenneté des organisations, qui appartiennent à des communautés plus larges et sont capables de contribuer activement. Que signifie pour une organisation de se considérer comme une citoyenne ? Organiser est une capacité humaine fondamentale au potentiel presque illimité. C’est comme un super-pouvoir… qui sert ensuite à vendre un produit et à faire des profits. Vraiment ? Quelle histoire profondément décevante nous racontons-nous sur ce que sont les organisations, leur raison d’être et le rôle que nous jouons en leur sein.
Je crois qu’il est possible de raconter une autre histoire, celle d’organisations qui sont des communautés autonomes de citoyens, animées par un objectif commun, contribuant de manière profondément significative et pertinente. Pour moi, c’est à cela que sert l’autonomie !
Je continuerai à explorer la question de la citoyenneté dans et au sein des organisations et je partagerai mes découvertes. Et vous ? Quel est pour vous l’intérêt et le potentiel de cette merveilleuse pratique transformatrice qu’est l’auto-gouvernance ?
A propos de l’auteur :
Diederick Janse est coach, formateur et cofondateur d’Energized.org, une organisation néerlandaise pionnière de l’Holacracy. Depuis 2007, il accompagne entreprises et collectifs dans la mise en place de modes de gouvernance distribuée favorisant la responsabilité et l’engagement. Il est aussi l’auteur de Getting Teams Done, un guide pratique pour les équipes qui veulent s’auto-organiser.

Aliocha Iordanoff
Découvrir d’autres articles de l’auteur !
À lire aussi .
Gouvernance additive, gouvernance soustractive : l’art d’élaguer nos organisations
« Dans Holacracy, on apprend d’abord à ajouter. Puis, plus tard, on découvre qu’il faut aussi savoir enlever. » — Dennis Wittrock, Holacracy verstehen (2024) Depuis plusieurs années, des chercheurs comme Stefan Kühl observent une tendance naturelle des organisations...
Nos expériences pour intégrer personnes Source et gouvernance en Holacracy
Lecture : 7 minutesDécouvrez comment Sémawé a expérimenté la combinaison des deux modèles que sont l’Holacratie et les principes Source depuis quelques années !
Comment concilier les statuts des personnes et les rôles ?
L’un des malentendus les plus fréquents quand une entreprise adopte l’Holacratie concerne la place des statuts des personnes. Faut-il créer un rôle “salarié” dans la gouvernance ? Un rôle “associé” ? Doit-on représenter quelque part que telle personne est mandataire...