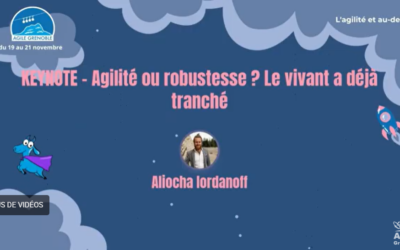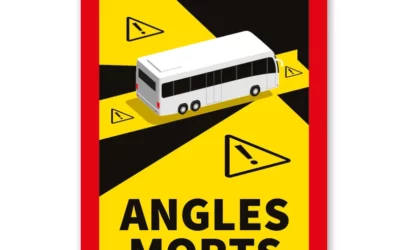Il m’arrive souvent d’entendre cette phrase, presque mot pour mot, lorsque j’échange avec un dirigeant ou un membre de CODIR : « J’aimerais beaucoup expérimenter l’Holacratie, mais je ne peux pas transformer toute l’organisation d’un coup. Alors est-ce que ça vaut le coup ? »
À chaque fois, ma réponse est la même, fondée sur plus de dix ans d’expérience auprès de dizaines d’organisations : oui, c’est non seulement possible, mais c’est souvent la meilleure manière de commencer.
Dans cet article, j’aimerais partager pourquoi cette démarche fonctionne, comment elle se met en place concrètement, ce qu’il faut sécuriser pour qu’elle s’intègre harmonieusement dans un environnement non holacratique, et surtout, pourquoi vous pouvez vous lancer sans crainte – même si votre organisation est grande, complexe, largement hiérarchique, ou traversée de multiples cultures managériales.
Je vais m’appuyer sur :
- les enseignements que je tire des accompagnements chez la Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole (leur gouvernance est publique !), le centre logistique de Grolley de l’Armée Suisse et des expériences d’Hypoport en Allemagne, ENGIE,
- la pratique quotidienne chez Sémawé,
- les expériences de Brian Robertson et Floris Hammer, qui travaillent depuis des années sur ces questions d’« îlots de pratique »,
Je veux que vous ressortiez de cet article avec une certitude : l’Holacratie n’est pas une révolution totale à imposer, c’est une manière d’apporter de la clarté, de la responsabilité et de l’agilité là où c’est possible, et là où ça fait du bien.
Et cela peut commencer très simplement.
1. Pourquoi l’adoption partielle fonctionne très bien
1.1. Les organisations sont hybrides, et c’est normal
Contrairement à ce que l’on imagine, aucune organisation n’est homogène. Même les groupes les plus structurés présentent une mosaïque de cultures internes : directions très processées, équipes très autonomes, dépendances externes, poches de résistance, zones d’expérimentation…
Dans une collectivité comme Grenoble Ville ou Grenoble Alpes Métropole, cette réalité est encore plus marquée : la direction des finances n’a pas la même culture que la direction des sports, la DSI n’a pas les mêmes rythmes que les équipes qui taillent les arbres, et certaines directions ont une forte tradition de gestion hiérarchique quand d’autres expérimentent volontiers.
Dans ces environnements, l’Holacratie n’arrive jamais sur un terrain vierge. Elle s’intègre dans un système préexistant d’habitudes, de culture de travail.
C’est pour cela que la démarche d’« îlot de pratique », ou island of practice, que décrivent Brian Robertson et Floris Hammer, est à la fois réaliste et pragmatique : aucune organisation n’a besoin de tout transformer d’un coup.
1.2. L’important n’est pas la taille, mais la clarté du périmètre
J’ai vu des équipes de 7 personnes fonctionner magnifiquement au sein d’un groupe de 3 000 salariés. Et j’ai vu l’inverse : un département de 200 personnes complètement paralysé parce que son périmètre n’avait jamais été clarifié.
L’Holacratie partielle fonctionne si l’on est capable de dire :
- cette équipe fonctionne selon ces règles,
- dans ce contexte précis,
- et voici ce que cela change – et ce que cela ne change pas.
C’est le parallèle que Brian Robertson fait souvent : si certains jouent au Monopoly et d’autres à Risk, tout se passe bien tant que chacun sait à quel jeu il est en train de jouer.
1.3. Cela améliore la performance, même isolé du reste
Les équipes que j’ai accompagnées en adoption partielle ont toutes vécu la même chose :
- plus de fluidité,
- une accélération dans les décisions,
- une clarification immédiate des attentes et responsabilités,
- une meilleure capacité à répondre à la demande des autres directions.
Et le reste de l’organisation voit rapidement l’amélioration.
2. Les idées reçues qui bloquent (à tort)
Je vois trois grandes craintes, presque universelles, chez les dirigeants.
2.1. « Nous allons créer du chaos si certains fonctionnent autrement »
C’est une confusion fréquente. L’Holacratie n’est pas un chaos : c’est un cadre extrêmement clair, plus clair et plus précis que n’importe quel système de management traditionnel.
Une équipe holacratique ne devient pas imprévisible, mais au contraire, elle devient lisible et se dote de référentiels écrits.
Ce sont les environnements flous, informels, implicites qui créent du chaos, pas l’Holacratie.
2.2. « Cela va entrer en conflit avec les politiques RH »
En réalité, il suffit souvent de traduire les contraintes de la maison mère en règles internes pour que tout reste fluide et compréhensible. C’est ce que nous avons fait chez Inddigo : le groupe avait des exigences très précises au sujet des validations RH et budgétaires. Les équipes qui fonctionnent en Holacratie ont simplement transcrit ces règles au sein de leur cercle.
Résultat :
- tout est clair,
- les règles sont précises et documentées,
- tout est intégré dans les outils (GlassFrog, Nestr, Holaspirit),
2.3. « Si l’équipe est plus efficace, la hiérarchie va se sentir menacée »
Sur le terrain, c’est exactement l’inverse qui se passe. Les managers, une fois rassurés, retrouvent de la bande passante pour faire leur job de management. Ils voient que les décisions se prennent mieux, que les arbitrages arrivent plus vite et que les sujets ne stagnent pas.
Dans les collectivités, par exemple à Grenoble Ville, j’ai vu plusieurs directeurs et directrices exprimer un soulagement : l’équipe en Holacratie devenait plus facile à manager que leurs équipes traditionnelles.
3. Les trois leviers essentiels pour réussir un « îlot de pratique »
Lorsque je parle d’Holacratie partielle, cela repose sur trois conditions de succès :
- La délimitation du périmètre
- La traduction des contraintes existantes (règles et procédures)
- L’adoption progressive des articles constitutionnels
Moyennant quoi, l’implémentation devient simple, fluide, robuste.
4. Levier n°1 : délimiter clairement le périmètre
4.1. Une équipe, un projet, un département : choisissez l’échelle la plus simple
On peut démarrer :
- à l’échelle d’un projet,
- d’une équipe,
- d’une direction entière,
- ou même d’un “micro-cercle” transversal.
Le plus important n’est pas la taille : c’est la lisibilité du périmètre.
Chez Grenoble Alpes Métropole, l’Holacratie a été introduite dans une direction d’une cinquantaine de personnes. Cette direction avait de nombreuses interactions transverses, mais son périmètre interne était clair : c’était suffisant pour réussir.
Chez Hypoport, au contraire, ils ont implémenté l’Holacratie sur un ensemble de 900 personnes parmi 2500, répartis dans plusieurs entités et métiers de l’entreprise, avec un accompagnement massif, et des coach internes formés à l’Holacratie.
Dans les deux cas, le secret n’était pas la taille : c’était le “qui joue à quoi, et quand”.
4.2. L’importance d’annoncer la règle du jeu
Une équipe en Holacratie ne doit pas « surprendre » le reste de l’organisation. Il faut expliquer simplement :
« Dans ce périmètre, nous utilisons un cadre de clarté basé sur les rôles. Vos interactions avec nous ne changent pas, mais pour nous organiser en interne, nous utilisons une méthode plus structurée. »
C’est tout ce qu’il faut.
5. Levier n°2 : traduire les contraintes existantes en Holacratie
Chaque organisation possède un cadre préexistant : procédures RH, règles budgétaires, obligations juridiques, normes métiers, délégations hiérarchiques, exigences de reporting. Et c’est normal. Une équipe qui adopte l’Holacratie ne devient pas une île totalement indépendante ; elle continue d’habiter un environnement institutionnel, politique, réglementaire ou corporate.
Et c’est justement là que se joue l’un des leviers les plus puissants et les plus méconnus.
Contrairement à l’image romantique d’une équipe autonome qui ferait tout « autrement », la première étape d’une adoption holacratique robuste consiste à honorer les contraintes. Et mieux encore : les traduire dans le langage Holacracy, afin qu’elles deviennent des règles explicites, visibles, assumées.
Nous le remarquons dans bien des cas, que ce soit dans une direction de Grenoble Ville, une direction métropolitaine, une BU d’ENGIE ou une entité du groupe Hypoport : les équipes souffrent rarement de l’existence des contraintes, elles souffrent du flou autour des contraintes.
5.1. Toute organisation a des règles non négociables
Dans une collectivité, vous ne contournez pas le Code des collectivités territoriales. Dans une administration, vous ne contournez pas les règles statutaires. Dans une grande entreprise, vous ne contournez pas les procédures RH ou les autorisations de dépenses.
Dans un système holacratique, ces règles continuent d’exister… et l’équipe qui adopte l’Holacratie n’a pas à s’en affranchir. Au contraire : elle les rend visibles.
Ces éléments normatifs ou contraignants ne doivent pas être contournés. Ils doivent être rendus explicites.
5.2. Comment les intégrer ? En les transformant en “règles” dans les cercles.
C’est ce qu’expliquent Brian Robertson et Floris Hammer : transformer l’implicite en explicite permet à l’équipe de fonctionner sereinement.
Lorsque nous accompagnons une équipe, la toute première étape, avant même d’introduire les règles de coopération, consiste à cartographier les rôles existants et à traduire le cadre extérieur dans la structure du cercle.
On transforme :
- une procédure RH → en règle claire,
- une délégation hiérarchique → en domaine d’autorité pour un cercle,
- une responsabilité managériale → en rôle,
- une règle budgétaire → en autorité explicite.
Et ce travail produit immédiatement deux effets :
- Personne ne croit plus que avec l’Holacratie, “on fait tout ce qu’on veut”. Le cadre réel, celui de l’organisation globale, est écrit, visible, assumé.
- L’équipe récupère de la marge de manœuvre. Car tout ce qui n’est pas contraint… devient autorisé et possible.
On ne gagne pas en autonomie en supprimant les contraintes, mais en clarifiant les limites. L’ambiguïté enferme davantage que la règle explicite car elle crée de l’inhibition.
5.3. Pourquoi cela apporte de la liberté ?
Parce que définir les contraintes libère tout ce qui n’est pas contraint.
Structure = liberté.
La plupart des contraintes organisationnelles sont dispersées dans :
- des slides,
- des PDF,
- des notes internes,
- des échanges informels,
- des habitudes historiques.
Même les managers ne savent pas toujours où se trouve « la vraie règle ».
En les rendant explicites :
- l’équipe comprend mieux ce qu’elle peut décider sans demander,
- les arbitrages deviennent plus simples,
- l’autonomie devient plus sûre,
- et le stress diminue.
Dans toutes les organisations que j’ai accompagnées, la clarification des limites a libéré davantage d’initiatives que n’importe quelle formation à “l’autonomie”.
C’est pour cela que je considère ce levier comme l’un des plus puissants de l’Holacratie.
6. Levier n°3 : adopter l’Holacratie par modules (et pas tout d’un coup)
Depuis la Constitution 5.0 (2021), l’adoption modulaire est officielle. On peut entrer dans l’Holacratie par étapes, article par article.
Je continue de penser – et l’expérience me donne raison – que l’adoption complète immédiate est la voie la plus efficace. Mais je vois aussi des directions qui préfèrent avancer progressivement, par prudence, par curiosité ou par nécessité politique.
Cette modularité est possible mais il est très important d’avoir clarifié par quoi ce choix est guidé. Est-ce par peur de quelque chose ?
Concrètement, on peut adopter :
- uniquement l’Article 1 pour utiliser les rôles, les cercles, les responsabilités explicités,
- et/ou ajouter l’Article 2, pour bénéficier des règles de coopération : transparence, priorisation, traitement des demandes, accords relationnels,
- et/ou ajouter l’Article 3, pour utiliser la réunion tactique là où elle est utile
- et/ou ajouter l’Article 4, pour aller jusqu’au bout de la logique d’autorité distribuée et favoriser les initiatives
- et/ou ajouter l’Article 5 pour bénéficier d’un processus d’intelligence collective très robuste et fonctionnel pour arbitrer les choix de structure d’autorité et de responsabilité.
6.1. L’article 1 seul change déjà la vie
Cet article introduit :
- la notion de rôle,
- les redevabilités,
- les domaines,
- la distinction entre personne et rôle.
Rien qu’avec cela, j’ai vu des équipes réaliser un bond qualitatif énorme. Chez la Ville de Grenoble, par exemple, nous avons souvent commencé par cette brique : elle permet de créer de la clarté sans impacter le reste de l’organisation.
6.2. L’article 2 : les règles de coopération (le “bon sens” écrit noir sur blanc)
C’est souvent là que les dirigeants me disent : « Oui, ça paraît évident… »
Cependant, une fois ces règles écrites noir sur blanc, beaucoup découvrent que ce “bon sens” n’était pas si bien pratiqué que ça.
L’article 2 met en lumière les fondamentaux de la coopération :
- la transparence (plus complexe qu’elle n’y paraît),
- la priorisation (qui exige une véritable discipline personnelle),
- le traitement des demandes,
- les obligations relationnelles professionnelles.
Cet article crée souvent autant de prises de conscience qu’un séminaire complet de management.
6.3. Les réunions tactiques sont un levier très simple et très puissant
Même sans gouvernance complète, les réunions tactiques apportent :
- un cadre clair,
- un processus fluide,
- un traitement rapide des tensions,
- une coordination plus efficace.
Dans certaines organisations, nous avons constaté jusqu’à 50 % de temps de réunion en moins, et une nette accélération des décisions. C’est souvent le premier choc positif : « Enfin une réunion qui sert à quelque chose. »
6.4. L’article 4 et 5 : les plus impressionnants… mais les plus transformateurs
C’est ici que beaucoup d’organisations hésitent. Pourtant ce sont ces articles qui transforment le plus les postures, la maturité, l’engagement, la responsabilisation.
L’erreur fréquente consiste à dire : « On va faire l’Holacratie, mais seulement les parties faciles. »
C’est une erreur stratégique, car on adopte alors uniquement ce qui ne change pas les habitudes existantes. On se prive alors de la transformation que ce cadre permet réellement.
Si vous n’adoptez que ce qui vous met à l’aise, ne vous attendez pas à autre chose que ce que vous connaissez déjà.
L’Holacratie est un framework structurant et c’est cette structure qui crée le changement.
7. Les erreurs fréquentes (et comment les éviter)
7.1. Sélectionner les parties “faciles” et éviter les parties “inconfortables”
C’est l’erreur n°1.
En ne prenant que les éléments logiques, naturels, déjà existants, on produit une version édulcorée du système. La valeur créée est limitée, et la déception s’installe très rapidement.
7.2. Croire que son contexte est “trop particulier”
Je l’entends partout :
« Oui mais chez nous c’est différent. »
« Chez nous c’est unique. »
« Nous avons des contraintes très spécifiques. »
C’est humain, et même plutôt banal. 100 % des organisations pensent être particulières. Et elles le sont… mais de la même manière que toutes les autres.
Les contraintes sont normales :
- charge de travail,
- compétences rares,
- usagers 24h/24,
- enjeux de sécurité,
- métiers techniques,
- dépendances externes,
- exigences politiques ou actionnariales.
Tout cela est commun et ne constitue pas des obstacles.
La vraie question n’est pas : « Est-ce que c’est possible ? » La vraie question est : « Est-ce que vous voulez changer quelque chose ? »
7.3. Sous-estimer la nécessité d’un mandat clair
Une équipe ne peut pas fonctionner en Holacratie dans l’ombre ou en clandestinité.
Il faut :
- un mandat explicite de la hiérarchie,
- une figure d’autorité légitime et pleinement impliquée,
- un signal clair envoyé à l’organisation : “Ici, nous fonctionnons selon cette règle du jeu.”
Sans cela, l’adoption est fragile, ambiguë, vouée à l’échec ou à la frustration.
8. Le cas particulier des managers dans une organisation hybride
C’est un point très sensible, surtout dans les grandes structures : que faire du manager dans une équipe holacratique ?
Beaucoup s’imaginent que l’Holacratie supprime les managers. C’est faux. Dans une organisation hybride, les managers continuent d’exister — formellement, contractuellement, institutionnellement.
L’Holacratie ne les retire pas et je dirais même qu’elle clarifie encore plus précisément leur fonction.
Voici ce que je peux faire par exemple :
- je crée un rôle “Manager”,
- je décris exactement son périmètre d’autorité réelle,
- je distingue ce qui relève de sa hiérarchie et ce qui relève de la structure distribuée,
- je fais apparaître les zones où leadership et hiérarchie se superposent,
Cette clarification est libératrice et les managers cessent de jouer à la fois les rôles de :
- superviseur,
- arbitre,
- tampon émotionnel,
- facilitateur informel,
- pompier,
- gardiens du flou.
Dans toutes les missions, j’ai vu que cela aide aussi les équipes extérieures à l’Holacratie, car cela réduit la confusion sur l’autorité, la validation, les responsabilités.
9. Comment savoir si votre organisation est prête ?
Je reformulerais la question autrement : “Voulez-vous améliorer quelque chose ?”
Si tout est parfait, stable, fluide, transparent, autonome… alors ne faites rien. Mais si vous souhaitez :
- faire mieux avec moins,
- fluidifier les décisions,
- développer la prise d’initiative,
- réduire les tensions relationnelles,
- améliorer la priorité collective,
- créer un climat de responsabilité réelle,
- améliorer la communication interne,
- renforcer la coopération spontanée,
alors oui : vous êtes prêts.
Conclusion : l’Holacratie n’est pas une finalité, mais une manière de travailler
L’Holacratie n’est pas un dogme ni “un supplément d’âme”. C’est un framework pragmatique centré sur le sens et l’efficacité.
C’est une manière d’organiser le travail, de décider, de communiquer, de collaborer. Une manière profondément adaptée à un monde où la stabilité n’est plus la norme.
Nos expériences montrent que ça fonctionne :
- Dans une petite équipe.
- Dans un grand service.
- Dans un groupe international.
- Dans une collectivité territoriale.
- Dans un îlot de pratique isolé ou dans une transformation globale.
L’Holacratie crée un environnement où :
- chacun peut prendre ses responsabilités,
- les décisions cessent de stagner,
- les managers retrouvent de la hauteur,
- les équipes gagnent en autonomie,
- la structure devient plus lisible,
- et l’organisation devient plus robuste.
Que vous soyez 5, 50 ou 5 000 : l’Holacratie partielle est un chemin solide, pragmatique et réaliste pour mieux travailler ensemble.

Aliocha Iordanoff
Découvrir d’autres articles de l’auteur !
À lire aussi
Agilité ou robustesse ? Le vivant a déjà tranché – replay keynote d’Aliocha Iordanoff à Agile Grenoble 2025
Faut-il choisir entre être agile ou être robuste ? "Vous avez tout optimisé, automatisé, fluidifié ? Bravo. Mais si c’était justement là que résidait la fragilité ? Dans un monde fluctuant, être très adapté à son environnement peut rendre vulnérable : l’histoire du...
Est-ce bien raisonnable d’écouter l’autre ?
L’écoute est présentée comme une évidence. Une posture mature, presque une obligation morale. Pourtant, dans les relations tendues, écouter peut devenir une très mauvaise idée. Non pas parce que l’écoute serait inutile, mais parce qu’elle est souvent mal comprise, mal...
Que signifie réellement la “transparence” en Holacratie ?
Que signifie réellement la “transparence” en Holacratie ? Le mot est omniprésent. Il est souvent invoqué comme une évidence morale, parfois brandi comme une exigence absolue. Et pourtant, sur le terrain, il génère beaucoup de confusion. « Est-ce que tout doit être...
Deux manières d’adapter l’Holacratie
Peut-on “adapter” l’Holacratie ? C’est l’une des premières questions que l’on nous pose lorsque nous accompagnons des organisations vers plus d’autonomie : « Est-ce que l’on peut garder l’esprit, mais adapter les règles à notre réalité ? » La question est légitime....
Tester les propositions de gouvernance, le système immunitaire de l’organisation
Dans la Constitution Holacratie, le Facilitateur dispose d’une responsabilité souvent méconnue : celle de vérifier qu’une proposition est recevable, avant même d’entrer dans le traitement des objections. En Holacratie v5.0, cette responsabilité s’appuie explicitement...
L’Holacratie a-t-elle des angles morts ?
Des lacunes vers la plénitude Un article de Dennis Wittrock publié le 13 juillet 2017 sur Medium, traduit par Aliocha Iordanoff. Les environnements économiques en mutation rapide favorisent l’agilité organisationnelle, rendue possible par une prise de décision...