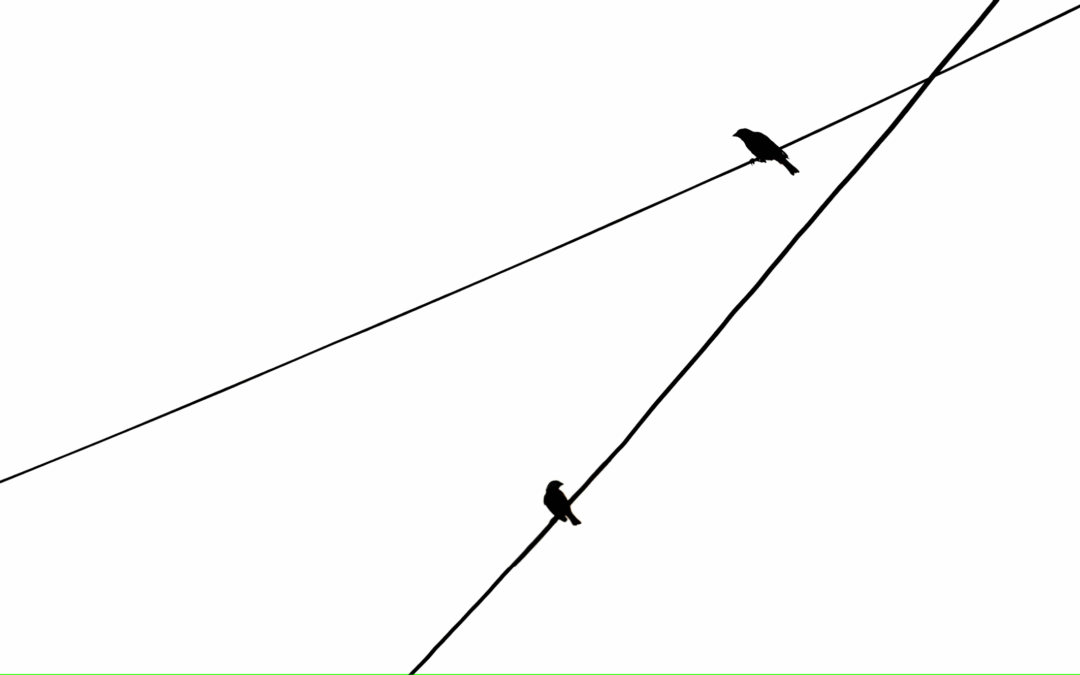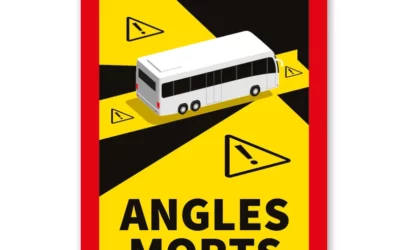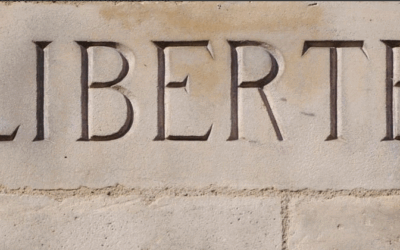L’un des malentendus les plus fréquents quand une entreprise adopte l’Holacratie concerne la place des statuts des personnes. Faut-il créer un rôle “salarié” dans la gouvernance ? Un rôle “associé” ? Doit-on représenter quelque part que telle personne est mandataire social, ou membre du CODIR ? Ces questions sont récurrentes et légitimes.
Car lorsqu’on fait l’expérience d’une gouvernance distribuée, tout ce qui échappe à l’architecture des rôles peut sembler flou, voire gênant. On cherche la cohérence et l’explicitation de toutes les attentes et responsabilités. On voudrait tout représenter. On voudrait que tout soit “dans la gouv”. Et pourtant, certains éléments de la réalité échappent, par nature, à la gouvernance en Holacratie. C’est le cas des statuts de personnes.
Cette confusion tient au fait que dans nos habitudes organisationnelles classiques, le statut d’une personne est souvent confondu avec son “poste”. Or, en Holacratie, la notion de poste disparaît, au profit d’une structure dynamique de rôles pour décrire le travail fait par les personnes. On pourrait donc être tenté d’“encoder” le statut de salarié ou d’associé sous forme de rôle, pour ne pas le perdre de vue. Mais cela pose de nombreux problèmes que nous allons explorer.
Cet article a pour objectif de clarifier les liens entre statuts et rôles dans une organisation fonctionnant en Holacratie, sans chercher à proposer une réponse unique. Au contraire : il s’agit d’introduire de la nuance, d’ouvrir des pistes, et de partager des pratiques concrètes issues du terrain. Car si l’Holacratie nous propose un cadre de gouvernance robuste, elle ne prétend pas absorber ou résoudre tous les héritages du droit du travail, du droit des sociétés, ou des cultures managériales.
En d’autres termes : les statuts ne disparaissent pas avec l’Holacratie. Mais notre manière de les intégrer dans l’organisation peut évoluer. Encore faut-il distinguer ce qui relève du système juridique, de ce qui relève du système d’autorité. Et c’est là que les rôles entrent en scène.
Rôles et statuts : deux logiques fondamentalement différentes
L’un des fondements de la gouvernance en Holacratie, c’est la dissociation radicale entre les rôles que l’on tient dans l’organisation, et les personnes qui les tiennent. C’est cette dissociation qui permet d’éviter les conflits d’autorité implicite, les jeux de pouvoir personnels, ou les attentes non clarifiées. Pourtant, dans la réalité quotidienne d’une entreprise, les personnes arrivent toujours avec un “statut” : salarié, associé, stagiaire, indépendant, mandataire… Et cela peut brouiller les pistes si l’on n’y prend pas garde.
Ce qu’est un rôle, en Holacratie
Un rôle est une structure explicite, définie par trois éléments :
- Une raison d’être (la finalité du rôle dans l’organisation),
- Des redevabilités (les activités attendues de manière continue),
- Éventuellement un ou plusieurs domaines (zones d’autorité exclusive).
Ce qui rend un rôle opérationnel n’est donc pas son titre, mais les attentes qui y sont associées et la clarté sur ses limites. Ces rôles peuvent être modifiés, fusionnés, scindés, abandonnés, réaffectés — en fonction des besoins de l’organisation. Ils existent pour servir la raison d’être du cercle qui les contient.
Extrait de la Constitution Holacracy, §1.4 :
« Un Rôle est une entité organisationnelle que l’on peut définir avec une Raison d’Être, des Redevabilités, et des Domaines. Chaque Rôle appartient à un Cercle qui l’intègre dans sa propre gouvernance. »
Ce qu’est un statut
Le statut, lui, n’est pas une construction organisationnelle, mais une qualité juridique, sociale ou institutionnelle attachée à une personne. Il peut résulter :
- d’un contrat de travail (statut de salarié),
- d’un lien capitalistique (statut d’associé),
- d’un pouvoir légal conféré par les statuts de l’entreprise (mandataire social),
- ou d’un régime social particulier (freelance, intermittent, etc.).
Un statut ne dépend pas de la gouvernance : il relève du droit du travail, du droit des sociétés, ou d’une convention contractuelle. Il détermine des responsabilités, des droits et parfois des pouvoirs que l’Holacratie ne peut ni créer, ni retirer, quand bien même l’organisation a signé une constitution.
Les dangers de la confusion
C’est ici que le risque apparaît : si l’on encode un statut comme un rôle, on induit l’idée que ce statut pourrait être modifié en réunion de gouvernance, ou qu’il serait soumis aux mêmes logiques d’évolution qu’un rôle classique.
Par exemple :
- Créer un rôle “Salarié” donnerait à penser qu’on pourrait devenir ou cesser d’être salarié par une simple affectation ou sortie du rôle, ou encore qu’on pourrait tout à fait modifier ce rôle dans un simple processus de gouvernance — ce qui est faux.
- Donner une redevabilité “Signer les comptes annuels” à un rôle sans préciser qu’il faut être mandataire légal pour le faire crée une ambiguïté.
En résumé : un rôle est gouvernable, un statut ne l’est pas. Il est donc essentiel de garder cette distinction claire, pour ne pas ouvrir la porte à des dérives de pouvoir ou à des incohérences juridiques.
Dans l’absolu, il serait possible d’encoder aussi la règle qui précise que certains rôles écrits dans l’holarchie ne sont pas gouvernables, mais cela pose vraiment la question de la lisibilité d’un tel design de cercles et rôles. Serait-ce réellement au service de plus de clarté dans l’organisation ?
Plusieurs organigrammes coexistent… et c’est normal
Lorsqu’une organisation adopte l’Holacratie, elle remplace généralement un organigramme pyramidal par une structure de rôles organisée en cercles. C’est un changement profond, souvent libérateur. Mais il ne faut pas pour autant croire que l’organigramme holacratique remplace toutes les autres cartographies de l’organisation. En réalité, plusieurs types d’organigrammes coexistent, et c’est non seulement normal, mais souhaitable.
L’organigramme fonctionnel, en cercles et rôles (la “gouvernance”)
C’est la cartographie créée et maintenue par les règles du jeu de l’Holacratie. Elle décrit :
- qui détient quelle autorité opérationnelle,
- comment les rôles sont articulés en cercles,
- les domaines protégés,
- les redevabilités explicites de chaque rôle.
Cette structure évolue en fonction des tensions de terrain, lors des réunions de gouvernance. Elle est vivante, distribuée, et centrée sur la raison d’être.
L’organigramme RH, une hiérarchie de personnes
C’est l’organigramme pyramidal si bien connu depuis la nuit des temps, qui présente une structure de personnes, rangées par ordre hiérarchique au sens où certaines personnes ont un lien de subordination avec d’autres.
Quoi que l’on pense philosophiquement de cette idée de la subordination, la pyramide managériale au sens RH du terme existe bel et bien à partir du moment où une entreprise embauche des salariés. Un salarié à un supérieur hiérarchique qui a autorité pour signer avec lui les évolutions de son contrat de travail.
La pyramide hiérarchique RH subsiste, même après l’adoption de l’Holacratie, aucune entreprise ne peut s’extraire de ses devoirs d’employeurs vis-à-vis du droit.
Dans bien des cas, les leaders de cercle ne sont pas forcément les supérieurs hiérarchiques des leaders de rôles qui détiennent un rôle dans le cercle.
La cohabitation des organigrammes fonctionnels et hiérarchiques sont donc bien utiles pour garder de la clarté sur les différences qui existent parfois entre une répartition des responsabilités fonctionnelles et hiérarchiques en sens RH.
L’organigramme juridique
Il s’agit ici d’un autre plan : celui des statuts légaux. On y trouve :
- les mandataires sociaux (gérant, président, DG),
- les associés, avec leurs droits de vote et leur capital,
- les salariés, avec leurs contrats et leur protection sociale,
- les indépendants, avec leurs relations contractuelles spécifiques.
Cet organigramme est figé par le droit. Il ne peut pas être modifié par une réunion de gouvernance. Pourtant, il a des effets très concrets sur la vie de l’entreprise : responsabilité pénale, représentation légale, droit au chômage, etc.
L’organigramme des personnes (et de l’informel)
Ce plan est souvent implicite. Il comprend :
- les relations interpersonnelles,
- les affinités naturelles ou historiques,
- les figures de leadership informel,
- les perceptions de pouvoir non déclarées.
Même dans un système de rôles, les personnes restent présentes, avec leur charisme, leur histoire, leur place dans le collectif. Ces dynamiques ne sont pas mauvaises en soi, mais il est utile de les rendre visibles pour mieux les comprendre.
Pour autant, nous ne sommes pas forcément outillés pour représenter visuellement un tel organigramme.
L’organigramme de la Source
Certaines organisations, notamment celles qui s’inspirent des travaux de Peter Koenig ou de Stefan Merckelbach ou Tom Nixon, reconnaissent aussi un autre plan de structuration : celui de la Source. La Source est ici comprise comme la personne à l’origine du projet, qui continue à porter la vision profonde du projet et de ses valeurs.
Ce plan n’a pas toujours de traduction juridique, ni de reconnaissance dans la gouvernance en Holacratie. Mais il a une influence réelle. Parfois, ce que nous appelons « tension » est en fait un frottement entre les choix d’un rôle… et l’intuition de la Source.
Il serait certainement complexe de dessiner encore un autre organigramme pour différencier les Sources des leaders de cercles, mais la différence fondamentale entre cette structure de sources et celle des rôles et des cercles, réside dans le fait que la source est intrinsèquement liée à une personne, là ou en Holacratie la structure fonctionnelle repose précisément sur une distinction du rôle et de la personne.
Assumer la coexistence, plutôt que chercher l’unification
Vouloir forcer tous ces plans à coïncider, c’est créer des confusions ou des rigidités. Le vrai enjeu n’est pas d’unifier tous les organigrammes, mais d’apprendre à naviguer consciemment entre eux, en connaissant les limites et les possibilités propres à chacun.
En Holacratie, on peut s’appuyer sur la gouvernance pour répartir des rôles fonctionnels. Mais cela ne nous dispense pas de prendre en compte les contraintes du droit, les dynamiques humaines, et parfois la légitimité d’une personne Source.
Ce que l’Holacratie ne transforme pas
L’Holacratie est un système de gouvernance. Elle permet de distribuer le pouvoir de manière explicite et évolutive à travers des rôles. Mais elle ne prétend pas remplacer les autres systèmes d’autorité existants dans une entreprise. En particulier, elle n’annule pas le droit du travail, le droit des sociétés, ni les réalités contractuelles ou institutionnelles.
Le domaine du droit reste entier
Dans une organisation en Holacratie, les personnes continuent d’avoir :
- des contrats de travail qui définissent leur statut de salarié (ou non),
- des liens capitalistiques qui font d’elles des associés, avec les droits qui en découlent,
- parfois des mandats sociaux, qui leur confèrent une responsabilité légale envers les tiers (banque, URSSAF, tribunal, etc.).
Aucun de ces éléments n’est encodé dans la Constitution Holacracy, et pour cause : ils relèvent d’un autre système d’autorité. Ils ne peuvent pas être modifiés par une décision de cercle. Il serait donc dangereux de faire comme si la gouvernance pouvait les absorber ou les transformer.
Une gouvernance n’a pas le pouvoir de licencier, d’embaucher ou de nommer un mandataire
Même si un cercle peut créer un rôle “Recrutement” avec la redevabilité “mener les entretiens d’embauche”, cela ne signifie pas que ce rôle peut juridiquement conclure un contrat de travail. Il faudra qu’une personne ayant la capacité juridique d’engager l’entreprise (souvent un mandataire social) signe ce contrat.
De même, la gouvernance ne peut pas, à elle seule :
- désigner ou révoquer un mandataire social,
- exclure un associé,
- négocier une rupture conventionnelle.
Ces décisions nécessitent l’intervention de personnes physiques habilitées par d’autres règles que celles de la Constitution de l’Holacratie : les statuts juridiques de la société, le Code du travail, ou les pactes d’associés.
Ce que cela signifie concrètement
Cela ne veut pas dire que ces sujets doivent être mis “hors sol” ou seraient tabous. Cela veut dire qu’ils doivent être traités avec une clarté sur leur nature. Une bonne pratique consiste à se poser la question suivante :
Cette autorité est-elle conférée par la gouvernance ? Ou bien par un contrat, un statut légal, une convention collective, ou un acte juridique ?
Si c’est le second cas, il est inutile (voire dangereux) d’encoder cette autorité dans un rôle. Cela peut générer une illusion d’autonomie, ou une confusion des responsabilités — avec potentiellement des conséquences juridiques graves.
D’ailleurs le préambule de la constitution précise bien que :
[...] les Ratificateurs transfèrent leur pouvoir de gouverner et de diriger l’Organisation aux règles et processus décrits dans cette Constitution, à l’exception toutefois de tout pouvoir sur lequel les Ratificateurs n’ont pas autorité.
En résumé
L’Holacratie transforme en profondeur la manière de fonctionner d’une organisation, mais elle ne change pas les règles du droit. Elle nous invite à mieux clarifier, distinguer, articuler. À tracer des frontières saines entre ce qui peut évoluer par gouvernance… et ce qui relève d’un autre cadre.
Comment représenter les statuts sans les fausser
Même si les statuts ne relèvent pas de la gouvernance en Holacratie, il peut être utile de les rendre visibles dans l’organisation — à condition de ne pas les confondre avec des rôles. L’enjeu est de cartographier sans gouverner, de signaler sans créer d’illusion de contrôle. Autrement dit : représenter sans encoder.
Voici plusieurs approches testées sur le terrain, avec leurs forces et leurs limites.
1. Utiliser des rôles “non gouvernables” dans un cercle dédié
Certaines organisations choisissent de créer un cercle spécial (par exemple : “Cercle des statuts”) dans lequel figurent des rôles comme :
- “Salarié”
- “Associé”
- “Mandataire social”
Ces rôles n’ont pas de raison d’être fonctionnelle, ni de redevabilités. Ils servent simplement de marqueurs symboliques ou juridiques. Ils ne sont pas destinés à être modifiés ou attribués via la gouvernance. Ils sont là à titre informatif.
Pour éviter les malentendus, il est crucial d’accompagner cette pratique d’une note explicative :
Ces rôles ne sont pas gouvernables, ne peuvent être ni fusionnés ni scindés, et ne confèrent aucune autorité opérationnelle.
2. Utiliser des codes couleur ou des icônes dans l’outil de gouvernance
Certains outils comme Holaspirit permettent d’ajouter des métadonnées ou des badges sur les personnes :
- une pastille bleue pour les salariés,
- une pastille verte pour les associés,
- une couronne pour les mandataires sociaux.
C’est simple, visuel, non intrusif. Et cela n’introduit pas de confusion dans la gouvernance. On peut même envisager un fichier externe (Notion, wiki, etc.) pour référencer ces informations de manière distincte.
3. Gérer les statuts en dehors du système de rôles
Une autre option consiste à ne rien représenter dans la gouvernance, mais à faire apparaître les statuts :
- dans un annuaire interne,
- dans un document de référence juridique,
- dans les procédures RH ou administratives.
C’est particulièrement adapté si l’organisation veut éviter toute hybridation entre le juridique et la gouvernance. On trace ici une frontière nette : la gouvernance sert à gérer le travail, le reste est traité ailleurs.
4. Ce qu’il faut éviter : encoder un statut comme un rôle fonctionnel
Par exemple :
- créer un rôle “Associé·e” avec la redevabilité “voter en AG”,
- créer un rôle “Mandataire” avec le domaine “représentation légale de l’entreprise”,
- ou encore créer un rôle “Salarié” et y rattacher toutes les fonctions RH.
Ce genre de confusion est risqué. Elle peut donner à penser que la gouvernance peut retirer ou réattribuer un statut, ou encore qu’un rôle confère un pouvoir qu’il n’a pas. Cela affaiblit à la fois la clarté juridique et la solidité du système en Holacratie.
En résumé
La représentation des statuts peut être utile, surtout pour éviter les zones d’ombre ou les malentendus. Mais elle doit être faite avec doigté, à part, et sans passer par les outils classiques de gouvernance. Une représentation n’est pas une délégation. Une visualisation n’est pas une autorité. Garder cette distinction vivante, c’est protéger la clarté des deux mondes : celui du droit, et celui de la raison d’être.
Trois cas à part : salarié, associé, mandataire
Tous les statuts ne soulèvent pas les mêmes enjeux dans une organisation en Holacratie. Certains, comme celui de salarié, interfèrent avec des fonctions RH ou de management. D’autres, comme celui d’associé, touchent à la propriété et à la gouvernance juridique. Enfin, le mandataire social est un statut particulièrement délicat, car il mêle pouvoir légal et responsabilité pénale. Voici un tour d’horizon nuancé de ces trois figures-clés.
Le statut de salarié
Le statut de salarié est sans doute le plus courant, mais aussi le plus piégeux à représenter dans une gouvernance distribuée. Il implique :
- un contrat de travail signé par une personne habilitée, qui s’apparente à un accord relationnel au sens de l’article 2.4 de la constitution.
- des obligations unilatérales de l’employeur (protection sociale, congés, subordination…),
- et, souvent, des attentes implicites de type “mon manager doit valider”, même si l’Holacratie cherche à en sortir.
Ce qu’il ne faut pas faire : créer un rôle “salarié” ou “employé” dans un cercle, ou utiliser les rôles pour définir qui est “dans l’équipe” et qui ne l’est pas.
Ce qu’on peut faire :
- créer un rôle RH en gouvernance avec des redevabilités précises (ex. : “mettre à jour les contrats de travail”),
- définir des règles claires (ex. : “tout recrutement doit être validé par un rôle ayant le domaine ‘signature de contrat’”),
- accompagner les salariés pour qu’ils comprennent que leur contrat les rattache à la structure juridique, mais que leur pouvoir d’agir est distribué par les rôles.
Le statut d’associé
Être associé, c’est détenir une part du capital et avoir un droit de vote en assemblée générale. Dans les SCOP ou entreprises à sociétariat élargi, cela prend encore plus de poids symbolique : on devient “co-propriétaire du projet”.
Le piège fréquent : faire de l’associé un statut d’exemplarité ou de pouvoir implicite (“puisque je suis associé, je dois valider ça”). Cela brouille la lisibilité de la gouvernance.
Ce qu’on peut faire :
- Créer un rôle “vie des associés”, si besoin, avec des redevabilités spécifiques (ex. : “animer les temps d’AG”, “représenter le sociétariat auprès de l’équipe”),
- Gérer les engagements comportementaux liés au sociétariat dans un pacte d’associés ou des accords relationnels, mais hors de la gouvernance en Holacratie,
- Séparer très clairement les droits attachés au capital (vote, dividendes…) de l’autorité dans l’organisation qui passe par les rôles, et les attentes en matière de posture et de comportement, qui passent par des ententes relationnelles.
Le statut de mandataire social
C’est sans doute le cas le plus délicat. Un mandataire social (président, gérant, DG…) représente légalement l’entreprise vis-à-vis des tiers, signe les comptes, engage sa responsabilité. Ce n’est pas un rôle qu’on peut affecter ou modifier dans un cercle.
Ce qu’il ne faut surtout pas faire :
- affecter ce statut à quelqu’un via une décision de gouvernance, (ou du moins, vous pouvez le faire mais il n’est pas du tout acquis que cela ait une validité juridique en cas de recours)
- croire qu’un rôle “Président” permet de signer les comptes ou d’agir au nom de l’entreprise.
Ce qu’on peut faire :
- Créer un cercle “Mandat social”, qui contient des rôles opérationnels délégués par les mandataires (ex. : “Préparer l’AG”, “Tenir la comptabilité légale”, etc.),
- Distinguer ce cercle de tout rôle décisionnaire,
- Documenter, dans un document externe, qui sont les mandataires et quels sont leurs pouvoirs, avec une phrase-type du genre :
“La présente structure de gouvernance ne régit pas la fonction de mandataire social, qui relève des statuts juridiques de l’entreprise. Toutefois, les personnes concernées peuvent déléguer certaines actions via des rôles dans ce cercle.”
En résumé
Salarié, associé, mandataire : trois statuts, trois logiques, trois risques de confusion. Dans chacun des cas, la gouvernance peut aider à clarifier, déléguer, fluidifier. Mais elle ne peut ni attribuer un statut, ni le retirer, ni en gérer les implications légales. Reconnaître cela, c’est protéger l’organisation contre les abus… tout en libérant ses dynamiques internes.
Posture, engagements, comportements : et si ce n’était pas une affaire de rôles ?
Dans la pratique, de nombreuses tensions autour des statuts ne viennent pas du droit, mais d’un flou sur les postures attendues. Que veut dire “être un bon associé” ? Que signifie “avoir une posture de mandataire” ? Pourquoi certains salariés “tiennent leur place” et d’autres non ? Ces enjeux sont réels. Mais la gouvernance en Holacratie n’est pas toujours le bon outil pour les traiter.
Le piège : vouloir tout encoder dans des rôles
Quand un collectif se demande comment renforcer l’engagement, la tentation est grande de créer un rôle avec des redevabilités du type :
- “être exemplaire dans sa posture”,
- “être garant de la culture d’entreprise”,
- “incarner l’esprit société”,
- “porter la vision”…
Mais ces formulations posent problème :
- elles ne sont pas gouvernables (car trop floues ou subjectives),
- elles risquent de figer des attentes implicites sans permettre la discussion,
- elles entretiennent la confusion entre rôle et personne, voire entre fonction et valeur morale.
La gouvernance sert à organiser le travail, pas à dire qui est une “bonne personne”. Ici le travail autour des responsabilités de la personne Source sera d’une grande aide !
L’alternative : les accords relationnels
Lorsqu’il s’agit de clarifier des postures attendues, mieux vaut passer par des accords explicites entre personnes, hors du système de rôles. Ces accords peuvent porter sur :
- le comportement attendu en tant qu’associé,
- la manière dont on se donne du feedback,
- la manière dont on prend des décisions ensemble en dehors du cadre Holacratie (ex. : en AG).
Ces accords peuvent prendre la forme de :
- chartes relationnelles,
- pactes d’associés ou de collaborateurs,
- engagements comportementaux librement consentis.
Ils ne sont pas gouvernables, mais discutables. Ils vivent dans un autre espace : celui de la relation, pas du rôle.
Et si l’on veut poser des contraintes d’affectation ?
Certaines organisations souhaitent tout de même poser des conditions pour accéder à certains rôles sensibles. Par exemple :
- “seuls les associés peuvent tenir ce rôle”,
- “ce rôle est réservé aux personnes ayant suivi telle formation”,
- “il faut une validation préalable pour être affecté à ce rôle”.
Dans ce cas, il est possible de créer des règles dans le cercle, qui posent des contraintes sur les affectations. Mais attention :
- cela ne doit pas porter sur la personne, mais sur des critères objectifs,
- cela ne peut jamais modifier le statut de la personne,
- et cela suppose une validation par le processus de décision intégrative.
Extrait Constitution Holacracy, §1.4.1 :
«Seul un Leader de Cercle peut affecter ou désaffecter un Rôle au sein du Cercle, à moins que le Cercle n’ait délégué le contrôle de l’affectation des Rôles à un autre Rôle ou processus. Une règle peut encadrer davantage le processus d’affectation ou de désaffectation de Rôle.»
En résumé
Quand on sent qu’un comportement, une posture ou un engagement n’est pas “au rendez-vous”, il est tentant de passer par la gouvernance. Mais ce n’est pas toujours le bon levier. Mieux vaut créer des espaces pour nommer ces attentes, en dehors des rôles, et développer une culture de feedback et de clarification. C’est là que se jouent la confiance, la maturité et la qualité du lien.
Ne pas corréler rôles, salaires et statuts : un enjeu de clarté et d’agilité
Une confusion fréquente dans les organisations en Holacratie consiste à associer directement un rôle à un statut, puis à une rémunération. Par exemple : untel a le rôle “Responsable commercial” → donc il est salarié → donc il touche tel salaire. Cette logique semble naturelle… mais elle introduit une rigidité dangereuse dans un système conçu pour être souple et évolutif.
Les rôles ne sont pas des postes
Un rôle est une fonction que quelqu’un remplit pour répondre à une tension organisationnelle. Il n’implique aucun engagement de durée, ni aucune contrepartie financière en soi. Il peut être :
- créé ou supprimé à tout moment,
- fusionné ou scindé selon les besoins,
- réaffecté sans passer par un entretien d’embauche ou une clause de sortie.
Si l’on rattache directement un salaire ou un statut à un rôle, on bloque cette dynamique. Le rôle cesse d’être un outil de travail pour devenir une identité figée. Et tout changement de rôle devient une négociation contractuelle ou émotionnelle, au lieu d’être un simple ajustement organisationnel.
Les effets pervers d’une corrélation directe
Voici ce que l’on observe fréquemment quand une organisation lie trop fortement statut, rôle et rémunération :
- Les personnes s’attachent émotionnellement à leurs rôles, comme à un poste.
- Il devient difficile de scinder un rôle : cela serait vécu comme une perte de pouvoir ou de reconnaissance.
- Le système devient opaque : on ne sait plus si une personne est payée pour sa présence, sa contribution, ou son “statut”.
- Le lien entre création de valeur réelle et rémunération se brouille.
Des alternatives plus saines
Pour éviter ces blocages, plusieurs options sont possibles :
1. Dissocier explicitement rôle et rémunération
Une personne peut remplir plusieurs rôles, mais son salaire dépend d’un système RH distinct, qui prend en compte les critères que l’organisation aura choisit de valoriser :
- sa séniorité,
- ses contributions globales,
- sa charge de travail moyenne,
- des critères partagés (transparence, grille, co-évaluation…).
- etc..
2. Créer un rôle RH dédié à la rémunération
Ce rôle pourrait par exemple avoir la redevabilité : “Construire et faire vivre un système d’évaluation et de rémunération cohérent avec la gouvernance distribuée de l’organisation.”
Et ne pas confondre ce rôle avec celui de “Responsable administratif” ou “Leader de Cercle”.
3. Documenter les règles de rémunération en dehors de la gouvernance
Dans une charte salariale, un document interne ou une politique RH partagée. Cela permet à la gouvernance de rester souple, tout en donnant de la sécurité aux personnes sur les critères de rétribution.
En résumé
L’Holacratie vise une organisation évolutive, claire et distribuée. Pour cela, il est essentiel de ne pas figer les rôles en y accrochant des éléments rigides comme un statut ou une rémunération. Cela ne veut pas dire que ces sujets doivent rester flous ou arbitraires. Au contraire : ils doivent être traités, mais dans un espace conçu pour cela, avec des règles explicites… et séparées de la gouvernance.
Conclusion — Clarifier sans tout vouloir gouverner
Adopter l’Holacratie, ce n’est pas effacer l’histoire, le droit ou les statuts. Ce n’est pas non plus croire que tout peut être représenté dans une gouvernance parfaite. C’est plutôt apprendre à distinguer les espaces, à reconnaître les limites de chaque cadre, et à articuler consciemment différents systèmes d’autorité.
Dans une organisation, il y a des rôles gouvernables, et des statuts non gouvernables. Il y a des logiques d’action, et des logiques de droit. Il y a des pouvoirs explicites, et des responsabilités informelles. Et tout cela coexiste, souvent sans se gêner… à condition de ne pas les confondre.
L’Holacratie n’est pas un outil pour tout absorber, mais un outil pour clarifier qui fait quoi, pourquoi, et dans quel cadre d’autorité. C’est une boussole pour la complexité. Et quand on l’utilise avec finesse, elle permet d’articuler :
- les fonctions juridiques de l’entreprise (mandat social, contrat de travail, capital…),
- les dynamiques humaines (relation, posture, maturité),
- et la structure évolutive du travail (rôles, cercles, tensions…).
L’Holacratie ne dit pas si vous devez être salarié, associé ou freelance. Elle ne dit pas qui vous êtes. Mais elle vous aide à mieux faire ce que vous avez à faire, et c’est déjà beaucoup !

Aliocha Iordanoff
Découvrir d’autres articles de l’auteur !
À lire aussi
Que signifie réellement la “transparence” en Holacratie ?
Que signifie réellement la “transparence” en Holacratie ? Le mot est omniprésent. Il est souvent invoqué comme une évidence morale, parfois brandi comme une exigence absolue. Et pourtant, sur le terrain, il génère beaucoup de confusion. « Est-ce que tout doit être...
Tester les propositions de gouvernance, le système immunitaire de l’organisation
Dans la Constitution Holacratie, le Facilitateur dispose d’une responsabilité souvent méconnue : celle de vérifier qu’une proposition est recevable, avant même d’entrer dans le traitement des objections. En Holacratie v5.0, cette responsabilité s’appuie explicitement...
L’Holacratie a-t-elle des angles morts ?
Des lacunes vers la plénitude Un article de Dennis Wittrock publié le 13 juillet 2017 sur Medium, traduit par Aliocha Iordanoff. Les environnements économiques en mutation rapide favorisent l’agilité organisationnelle, rendue possible par une prise de décision...
Les processus de réunion en Holacratie, un cadre pour mieux s’écouter
2 processus au service de l'écoute et de l'expression On dit souvent que les réunions en Holacratie sont rigides. Les tours, les étapes, les consignes sans discussion... À première vue, tout cela peut sembler mécanique. En réalité, cette structure n’est pas là pour...
*Ilots de pratique : mettre en place l’Holacratie dans une partie seulement de l’organisation, pourquoi c’est simple, pourquoi ça marche ?
Il m’arrive souvent d’entendre cette phrase, presque mot pour mot, lorsque j’échange avec un dirigeant ou un membre de CODIR : « J’aimerais beaucoup expérimenter l’Holacratie, mais je ne peux pas transformer toute l’organisation d’un coup. Alors est-ce que ça vaut le...
*En quoi la citoyenneté est au cœur de l’autogouvernance ?
Article original, How Citizenship is at the heart of self-governance écrit par Diederick Janse – 17 mai 2023Traduit par Aliocha Iordanoff - 03 novembre 2025Je pratique passionnément l’auto-gouvernance depuis plus de quinze ans. Je la définis comme le fait de...