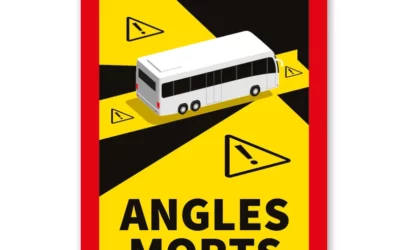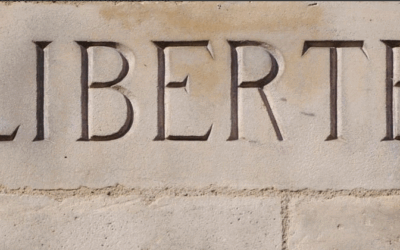[cet article s’adresse à des leader déjà familiers des concepts d’Holacratie et de Source, si tu en es plutôt à la découverte de ces modèles, voici quelques articles à lire avant :
- Le « principe Source » : partout où il y a un projet, il y a une « Source »
- Leadership vivant et hiérarchie naturelle : comprendre le rôle de la Source
- Qu’est-ce que l’Holacratie en 3 minutes ]
Je dirige, choisis les priorités, prends des décisions, exprime des tensions tous les jours en tant que dirigeant d’une PME. J’ai passé des années à faire ça sans cadre, puis avec l’Holacratie, et depuis quelques années en travaillant la posture de Source.
Cet article est un témoignage de mes expériences sur la compatibilité de ces deux modèles. En résumé : c’est compatible, complémentaire, mais il reste des questions ouvertes.
L’Holacratie donne l’ossature (règles du jeu explicites, rôles, cercles, décisions déclenchées par des tensions). La Source donne l’élan (une personne tient le champ et décide du prochain pas).
Ce mariage fonctionne, et il manque encore une pièce : une représentation visuelle et opérationnelle vraiment pratique pour que ça vive au quotidien à l’échelle d’une organisation.
“Source globale unique” et “autorité distribuée” ne se contredisent pas. Une source est unique sur son champ et reconnaît des sources spécifiques à l’intérieur du sien. En Holacratie, l’autorité s’exerce via des règles claires ; le Leader de cercle affecte les leaders de rôle, on peut en nommer plusieurs pour un même rôle, et on peut formaliser tout processus d’affectation en gouvernance. Les deux logiques se complètent si on inscrit explicitement la Source dans le système d’autorité.
Tom Nixon résume bien le paradoxe fondateur à résoudre : rien ne démarre sans fondateur… et pour grandir, il faut décentraliser. Mon travail consiste à tenir ces deux vérités ensemble, sans folklore et sans dilution.
Liens utiles pour aller plus loin en cours de lecture
→ L’art de naviguer dans le doute quand on est à la Source · Robustesse & subsidiarité · Source, hiérarchie créative & argent · 10 raisons de ne pas utiliser l’Holacratie · Culture d’entreprise & Holacratie · Polarités
Le dilemme à résoudre : “différenciation rôle/personne” vs “source intimement liée à un individu”
Je pose la scène telle que je la vis.
- Côté Source. Une source tient l’origine et les frontières d’un champ. Le champ est l’espace qui désigne le dedans, en négatif de ce qui ne fait pas partie du projet. Elle décide du prochain pas et reconnaît des sources spécifiques dans son champ. Cette reconnaissance est une autorité claire sur l’architecture créative du projet, sur ce qui en fait partie ou non, sur sa vision.
- Côté Holacratie. L’autorité est explicite et distribuée via une Constitution. Le Leader de cercle affecte les leaders de rôle ; une organisation peut décider en gouvernance d’un autre processus ; plusieurs personnes peuvent être leaders du même rôle, les rôles sont de la pâte à modeler qui s’adapte en continue à la vie de l’entreprise. Cela rend l’architecture lisible, transmissible, très agile, et moins dépendante des personnes.
Un manière de distinguer les deux approches est d’imaginer qu’elle servent à regarder dans des directions différentes :
- Le plan de l’origine, là d’où viennent les intuitions, comment émerge la vision. Qui tient le champ, à quel niveau, et qui sont les sources spécifiques reconnues à l’intérieur ? La notion de hiérarchie créative (source globale → sources spécifiques) nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes sont plus légitimes que d’autres dans leurs initiatives, indépendamment des rôles assumés.
- Le plan de la réalisation, qui se préoccupe de la réalisation concrète, de la gestion du travail à faire, de l’argent. Qui fait quoi, qui décide de quoi, qui détient quelle autorité ? Je m’appuie pour cela sur les mécanismes de l’Holacratie (affectations, gouvernance) pour que la collaboration reste fluide dans le temps.
2) Nos trois expérimentations — ce qui a marché, ce qui a coincé
Expérience 1 — Tenir deux cartes : l’holarchie des rôles et « le Conseil des sources »
J’ai d’abord tenté une double cartographie. D’un côté, l’holarchie Holacratie classique dans Holaspirit : cercles, rôles, redevabilités, décisions en gouvernance. De l’autre, une holarchie des sources avec un cercle dédié, « le Conseil des sources », tenu par la source globale, et, à l’intérieur, des sources spécifiques par thème. Cette voie part d’un constat simple : un leader de cercle n’est pas toujours la source de son sujet, et l’alignement « leader de cercle = source » ne se vérifie pas partout. Tenir deux plans séparés promettait de la clarté.
Nous avons mené une retraite d’équipe pour identifier les sujets où chacun se sentait légitime à « sentir » et à décider sur la base de ses intuitions, en assumant une part de risque. La légitimation croisée par les pairs a joué un rôle important pour permettre à certains d’assumer publiquement leur créativité sur un champ. Nous avons cartographié le tout en cercles imbriqués, en veillant à ce que chaque source spécifique soit reconnue par la source globale du champ plus large. Sur le moment, la visualisation a soulagé l’équipe et a levé des ambiguïtés de responsabilité.
Cette structure n’a pourtant pas tenu. Sa maintenance demandait une énergie que nous n’avons pas fournie ; des collègues peinaient à s’y repérer ; la carte s’est figée, puis a cessé de vivre. Je l’ai retirée.
L’essai reste fécond : il confirme la différence de nature entre l’architecture d’autorité (rôles) et l’architecture d’origine/légitimité (sources), et montre que vouloir gérer deux holarchies à parts égales finit souvent par l’obsolescence de l’une des deux.
Expérience 2 — Qualifier la « source du rôle » par une échelle de maturité
J’ai ensuite travaillé une échelle de maturité appliquée aux rôles : survie → efficacité → entrepreneur → source du rôle. L’idée : rendre visible qu’on attend, pour certains rôles, une initiative guidée par l’intuition, là où d’autres exigent surtout l’exécution rigoureuse des redevabilités. Chaque leader de cercle pouvait marquer des rôles pour expliciter cette attente.
Ce cadre a éclairé des implicites… sans créer, à lui seul, la progression espérée. Il a surtout révélé des écarts de maturité déjà présents : des personnes facilement reconnues comme source de leur sujet, d’autres pour qui l’identification restait difficile. Nous avons abandonné la coloration des rôles, tout en gardant l’intérêt de la définition : oui, certains rôles gagnent énormément quand le titulaire devient « source du rôle » ; d’autres n’en ont pas besoin.
Ce que ces essais m’enseignent
D’abord, la reconnaissance demeure le pivot : une source spécifique existe par la reconnaissance explicite de la source globale, avec une portée claire et des frontières assumées. Sans cet acte, la « source spécifique » n’est qu’une étiquette. Et lorsque la source globale délègue un sous-champ, elle renonce à recevoir les intuitions de ce sous-champ et vérifie surtout la compatibilité avec la vision plus large ; symétriquement, la source spécifique reçoit ses propres intuitions et porte la responsabilité du prochain pas dans sa portion. Cette hygiène relationnelle évite une grande partie des confusions.
Ensuite, je constate une aisance collective à identifier la source globale (valeurs, raison d’être, vision des prochains pas) et une difficulté plus grande à faire quelque chose d’opérationnel, stable et léger avec les sources spécifiques. Le terrain reste ouvert ; je continue d’expérimenter, en privilégiant des formes minimales qui n’alourdissent pas le quotidien.
Enfin, le pont avec Holacratie existe déjà. La définition de la tension comme écart ressenti entre une réalité et un potentiel appelle une sensibilité proche de celle que je mobilise en posture de Source. Être leader de rôle, c’est prendre des initiatives pour résoudre ces écarts. Cette grammaire me permet d’articuler l’élan (prochain pas de la Source) et l’exécution (dans le rôle adéquat), tout en conservant des décisions de gouvernance dès qu’on touche à l’autorité. Je demeure attentif à ne pas mélanger les plans : l’origine et la légitimité d’un champ d’un côté ; l’autorité distribuée dans les rôles de l’autre.
En résumé : la double carte m’a donné de la clarté puis a surchargé la maintenance ; l’échelle de maturité a donné un langage puis a montré ses limites comme levier. Je garde une règle simple : nommer les champs, identifier la source globale, reconnaître parcimonieusement des sources spécifiques avec des frontières nettes, et revenir au prochain pas qui fait avancer. Tout le reste se tisse dans l’holarchie, avec ses mécanismes d’affectation et de gouvernance.
Ce que je retiens des deux essais
- L’Holacratie porte déjà une logique proche de la Source : un leader de rôle prend des initiatives pour résoudre des tensions (écarts perçus entre réalité et potentiel). Ce geste appelle la sensibilité ; il rejoint l’esprit du prochain pas.
- La source globale est unique sur son champ et reconnaît des sources spécifiques. Cette architecture se combine avec la distribution d’autorité par rôles si je l’inscris clairement (règles / accord relationnel).
Nous en sommes là. Pour l’instant, aucune représentation visuelle probante, et nous continuons d’investiguer ce champ de travail !
Expérience 3 — Le pacte d’associés : exprimer les valeurs du champ par la Source globale
Je cherchais une manière simple d’inscrire la Source dans notre système d’autorité, sans construire une seconde carte et sans court-circuiter l’Holacratie. J’ai rédigé un pacte d’associés, qui au sens de la constitution en Holacratie est un accord relationnel contraignant entre les membres de l’équipe.
Dans cet accord écrit, chaque membre de l’organisation reconnaît le principe de la personne Source et son autorité légitime pour exprimer et garder les valeurs du champ.
C’est un texte court, clair, révisable, qui rend visible :
- le champ (intention, frontières, critères d’alignement) ;
- la Source globale et la signification de son rôle
- l’articulation avec l’holacratie
Effets observés
- Une boussole partagée pour trancher quand les sensibilités divergent.
- Moins de débats circulaires : la Source globale nomme les valeurs du champ
- Une transmissibilité plus grande : les nouveaux arrivants comprennent vite “qui tient quoi” et pourquoi.
Mais cette piste ne nous a pas aidé à transposer dans le quotidien la puissance de modèle de la Source appliqué aux sources spécifiques.
Mon apprentissage
Le pacte tient parce qu’il exprime la valeur du champ dans les mots de la Source globale, tout en canalisant l’élan vers l’holarchie. Il ne multiplie pas les artefacts. Il clarifie l’origine, rend partageable l’élan, et évite les confusions entre autorité distribuée et structure sans hiérarchie.
Conclusion
Je dirige une entreprise en Holacratie depuis des années et je travaille sur la posture de Source avec la même exigence. Mon constat est clairement que ces deux logiques se complètent merveilleusement. En tous cas, elles m’ont aidé dans mon chemin de leader.
L’Holacratie donne une structure claire d’autorité distribuée. La Source donne l’élan, l’intuition et le prochain pas. Ensemble, elles aident une organisation à rester vivante, lisible et responsable.
Ce que je garde de mes essais est qu’il est intéressant de nommer les champs de source qui comptent. Je m’identifie en tant que la source globale et je reconnais, quand c’est juste, des sources spécifiques à l’intérieur de ce périmètre créatif. Mais pour l’instant, il manque encore une représentation visuelle vraiment pratique. Je continue d’explorer ce point. Je cherche un schéma si clair qu’il se comprend en dix secondes et qu’il se met à jour sans effort.
Tant que je ne l’ai pas, je préfère une visualisation frugale et des rituels sobres plutôt qu’une seconde carte qui s’épuise.

Aliocha Iordanoff
Découvrir d’autres articles de l’auteur !
À lire aussi
Que signifie réellement la “transparence” en Holacratie ?
Que signifie réellement la “transparence” en Holacratie ? Le mot est omniprésent. Il est souvent invoqué comme une évidence morale, parfois brandi comme une exigence absolue. Et pourtant, sur le terrain, il génère beaucoup de confusion. « Est-ce que tout doit être...
Tester les propositions de gouvernance, le système immunitaire de l’organisation
Dans la Constitution Holacratie, le Facilitateur dispose d’une responsabilité souvent méconnue : celle de vérifier qu’une proposition est recevable, avant même d’entrer dans le traitement des objections. En Holacratie v5.0, cette responsabilité s’appuie explicitement...
L’Holacratie a-t-elle des angles morts ?
Des lacunes vers la plénitude Un article de Dennis Wittrock publié le 13 juillet 2017 sur Medium, traduit par Aliocha Iordanoff. Les environnements économiques en mutation rapide favorisent l’agilité organisationnelle, rendue possible par une prise de décision...
Les processus de réunion en Holacratie, un cadre pour mieux s’écouter
2 processus au service de l'écoute et de l'expression On dit souvent que les réunions en Holacratie sont rigides. Les tours, les étapes, les consignes sans discussion... À première vue, tout cela peut sembler mécanique. En réalité, cette structure n’est pas là pour...
*Ilots de pratique : mettre en place l’Holacratie dans une partie seulement de l’organisation, pourquoi c’est simple, pourquoi ça marche ?
Il m’arrive souvent d’entendre cette phrase, presque mot pour mot, lorsque j’échange avec un dirigeant ou un membre de CODIR : « J’aimerais beaucoup expérimenter l’Holacratie, mais je ne peux pas transformer toute l’organisation d’un coup. Alors est-ce que ça vaut le...
*En quoi la citoyenneté est au cœur de l’autogouvernance ?
Article original, How Citizenship is at the heart of self-governance écrit par Diederick Janse – 17 mai 2023Traduit par Aliocha Iordanoff - 03 novembre 2025Je pratique passionnément l’auto-gouvernance depuis plus de quinze ans. Je la définis comme le fait de...