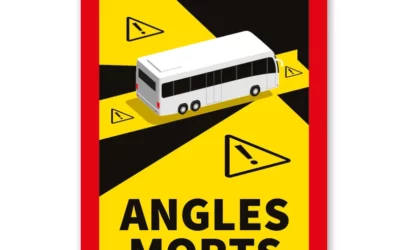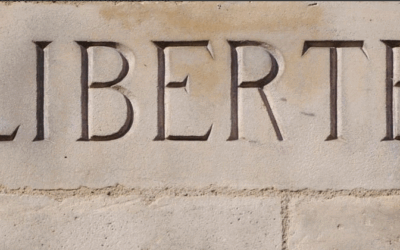L’argent, ce miroir qu’on évite de regarder
On aime penser que notre rapport à l’argent est rationnel. Que nos décisions salariales, nos discussions budgétaires, nos réflexes de dépense ou d’épargne répondent à des logiques solides, équilibrées.
Pourtant, il suffit de gratter un peu pour voir apparaître autre chose : de la gêne, du silence, du jugement, parfois même de la honte ou du ressentiment.
Dans beaucoup d’entreprises, parler d’argent reste un tabou. Là où, ailleurs, la transparence est devenue une norme assumée, source de fierté collective.
Pourquoi ces écarts ? Pourquoi cette tension si universelle ?
À travers mon expérience de fondateur de Sémawé, et d’accompagnant d’équipes sur ces questions délicates, j’ai vu combien l’argent n’est pas un sujet comme les autres.
Il touche au plus intime. Il vient titiller nos blessures, nos croyances, nos réflexes de survie.
Et parce qu’il est si chargé, il nous offre aussi — à condition d’oser le regarder — l’une des plus belles portes d’entrée vers la connaissance de soi et la libération collective.
Cet article propose un regard décalé sur notre rapport à l’argent. Un regard qui ne cherche pas à nier la difficulté, mais à la traverser autrement. À réconcilier justice et subjectivité. À assumer, plutôt que masquer, ce que l’argent révèle de nous.
1. Parler d’argent, c’est parler d’humain
Il y a des entreprises où l’argent circule comme une information parmi d’autres. Les salaires sont affichés. Les augmentations discutées. Les primes débattues collectivement. Il y a des entreprises où l’argent est un secret lourd. Où les salaires se devinent, se murmurent, s’imaginent autour d’une machine à café.
Ce contraste n’est pas anodin.
Quand l’argent est tabou, il crée du vide. Et ce vide, notre cerveau s’empresse de le combler. Nous fabriquons des mythologies, des présupposés : “Il est mieux payé parce qu’il est proche du patron”, “Elle a dû négocier mieux que moi”, “Les primes sont distribuées à la tête du client…”. À défaut de savoir, nous brodons.
Ce réflexe n’a rien de pathologique. Il est profondément humain. Face au flou, nous cherchons du sens. Face au silence, nous construisons des récits. L’argent devient alors moins un sujet en soi qu’un révélateur de nos besoins de clarté, de reconnaissance, de justice.
Et c’est là que réside une clé : parler d’argent, ce n’est pas seulement parler de chiffres. C’est parler de ce que nous voulons être pour nous-mêmes et les uns pour les autres.
2. La parabole des ouvriers de la onzième heure
Il est des récits anciens qui traversent les siècles sans perdre leur pouvoir de nous interroger. La parabole des ouvriers de la onzième heure, racontée dans l’Évangile selon Matthieu, en fait partie.
« Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.
Il convint avec les ouvriers d’un denier par jour, et il les envoya à sa vigne.
Il sortit vers la troisième heure et en vit d’autres qui se tenaient, désœuvrés, sur la place.
Il leur dit : “Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste.”
Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et la neuvième heure, et fit de même.
Vers la onzième heure, étant sorti, il en trouva d’autres qui se tenaient là, et il leur dit : “Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?”
Ils lui répondirent : “C’est que personne ne nous a embauchés.”
Il leur dit : “Allez, vous aussi, à ma vigne.”
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers.”
Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier.
Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage ; mais ils reçurent eux aussi chacun un denier.
En le recevant, ils récriminèrent contre le maître de maison :
“Ces derniers n’ont fait qu’une heure, et tu les as traités à l’égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur.”
Mais lui, s’adressant à l’un d’eux, répondit : “Ami, je ne te fais pas de tort ; n’es-tu pas convenu avec moi d’un denier ?
Prends ce qui est à toi et va-t’en. Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi.
Ne m’est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui m’appartient ? Ou ton œil est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?”
Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »
(Matthieu 20, 1-16, TOB)
Cette parabole, d’une limpide simplicité, fait pourtant vaciller notre intuition de la justice. Nous croyons que ce qui est juste doit être proportionnel. Nous croyons que l’effort doit être récompensé à hauteur de son intensité, de sa durée, de son mérite.
Mais ici, ce n’est pas la quantité de travail qui définit la rémunération. C’est l’accord conclu, la parole donnée, et la liberté souveraine du maître de rétribuer selon sa propre générosité.
En creux, cette histoire nous interroge : à quoi obéit notre sentiment d’injustice ? À un calcul ? À une comparaison ? Ou à quelque chose de plus profond, d’invisible, qui touche à notre rapport à l’engagement, à la reconnaissance, à la dignité ?
Elle nous rappelle que l’équité perçue n’est pas nécessairement l’équité réelle, et que ce décalage, loin de nous condamner à la frustration, peut devenir un chemin d’interrogation intérieure.
3. Peut-on rendre la rémunération plus juste ?
À la lumière de cette parabole, une question surgit, inévitable : est-il possible d’instituer un système salarial véritablement juste ?
Depuis des décennies, les entreprises tentent d’objectiver la rémunération. Elles multiplient les critères, ajoutent des échelles d’ancienneté, d’expérience, de performance, d’heures travaillées, d’efforts fournis, de responsabilités assumées. Elles espèrent ainsi sécuriser une forme de justice, à la fois mesurable et acceptable.
Mais dans l’expérience, la réalité est souvent plus nuancée. Chaque tentative d’objectivation apaise certaines tensions… tout en en faisant naître de nouvelles ailleurs.
Lorsque l’on paie à l’heure travaillée, le sentiment d’injustice naît autour de la question de l’intensité de l’effort.
Lorsque l’on paie à l’expérience, le sentiment d’injustice émerge autour de la valeur de la prise de risque, de l’innovation, du mérite actuel.
Lorsque l’on récompense les résultats commerciaux, naissent des comparaisons sur la difficulté des missions confiées, le caractère essentiel de missions dites “support”, moins visibles.
Chaque critère introduit une logique, mais aussi une part d’arbitraire. Et dans cette part d’arbitraire, chacun projette ses propres attentes, ses blessures, ses interprétations… et à la fin le verdict d’injustice.
La complexification des grilles salariales n’éteint pas le sentiment d’injustice ; elle le déplace, le diffuse, parfois l’exacerbe. Un système trop complexe devient opaque, et l’opacité ravive les soupçons. Un système trop égalitaire ignore les réalités vécues, et l’égalité elle-même devient une source d’injustice ressentie. Égalité qui est intrinsèquement figée sur une vision précise du monde, par essence subjective : égalité de salaire horaire, égalité entre les individus, égalité à l’aune de quoi ?
Le sentiment d’injustice ne naît pas de l’inégalité mesurable, mais de la dissonance perçue entre la valeur que je crois incarner et la reconnaissance que je reçois. Et cette dissonance est éminemment subjective.
Ainsi, toute tentative d’établir un « système parfaitement juste » se heurte à cette vérité simple : la justice perçue est d’abord une affaire intime, enracinée dans l’histoire, les valeurs profondes, les aspirations et les blessures de chacun.
À force de multiplier les critères, d’ajuster les équations et de raffiner les grilles, nous pourrions oublier l’essentiel : l’argent ne mesure pas uniquement une contribution, il révèle une relation. Et toute relation, même lorsqu’elle se veut juste, est traversée d’attentes, d’histoires anciennes, d’élans parfois invisibles.
Reconnaître cette part irréductiblement humaine, c’est peut-être cesser de chercher à tout contrôler. C’est oser ouvrir un espace où l’on parle non seulement de chiffres, mais aussi de ce que l’on est, de ce que l’on espère, de ce que l’on se donne.
Chez Sémawé, c’est dans cet esprit que nous avons choisi de réinventer notre rapport à l’argent.
4. L’expérience de Sémawé : assumer la subjectivité concernant l’argent
Chez Sémawé, nous avons fait le choix de ne plus chercher un système de rémunération parfaitement objectif. Non par résignation, mais par fidélité à ce que j’observe en nous-mêmes, et autour de nous : la question de l’argent est inévitablement subjective.
Chacun porte son propre rapport au mérite, au besoin, à la reconnaissance. Chacun, selon son histoire, ses blessures ou ses espérances, perçoit la justice salariale selon des filtres qui lui sont uniques.
Plutôt que d’imposer une mécanique impersonnelle censée aplanir ces écarts — mais qui, en réalité, les déplace ou les étouffe — nous avons choisi d’accueillir cette diversité.
Concrètement, cela prend la forme d’un processus interne où chaque collaborateur peut exprimer :
- son positionnement relatif par rapport aux autres,
- ses attentes en termes de valeur reconnue,
- son rapport personnel à l’argent, sans obligation de justification rationnelle.
Nous avons assumé qu’il n’existe aucune grille universelle capable de capturer toute la complexité d’une contribution humaine. Aucune équation ne peut contenir ce qui relève aussi de l’engagement, de la fidélité, du courage parfois silencieux.
Cette approche a transformé nos discussions.
Là où l’objectivation produisait souvent crispations ou méfiance, l’espace subjectif a permis des conversations plus vraies, plus intimes parfois. Il a permis à chacun de porter ses propres incohérences avec honnêteté, et de rencontrer celles des autres sans prétendre les résoudre à tout prix.
Assumer la subjectivité, ce n’est pas abandonner toute exigence ou toute recherche d’équité. C’est reconnaître que la justice vivante passe par la parole, par l’écoute, par l’acceptation du différend, plutôt que par sa négation.
Je témoigne plus précisément dans cet article sur la transparence sur les salaires.
5. Quand il s’agit d’argent, se comparer est humain — et peut-être une chance
Certaines visions du développement personnel, en lutte contre les dictats de l’égo, soutiennent qu’il faudrait abolir toute comparaison entre les personnes. Ne plus se mesurer, ne plus se jauger, ne plus se demander où l’on se situe par rapport aux autres.
Cet idéal de non-comparaison est beau. Mais il ignore une réalité plus profonde : se comparer est une fonction naturelle de l’esprit humain.
Au cœur même de notre cerveau, une minuscule structure appelée striatum s’active chaque fois que nous nous comparons. Elle déclenche une décharge de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Comme le besoin de manger, comme l’élan du désir, comme la soif de pouvoir ou le besoin de repos, la comparaison est une impulsion primitive, enracinée dans notre biologie.
Se comparer permet d’évaluer, d’ajuster, de comprendre notre place au sein du groupe. C’est un outil social essentiel, une manière de capter où est la force, où est la menace, où sont les alliances possibles. Ce n’est pas un défaut moral, c’est une fonction vitale !
Refuser cette réalité, c’est se condamner à lutter contre un moteur intérieur aussi puissant qu’inconscient. L’accepter, en revanche, ouvre une autre voie : celle d’une comparaison consciente, assumée, qui ne cherche pas à écraser l’autre ni à se réduire soi-même.
Dans nos discussions sur l’argent, chez Sémawé comme ailleurs, il ne s’agit pas de prétendre que nous ne nous comparons pas. Il s’agit de regarder ce réflexe en face, de le reconnaître comme un mouvement naturel, et d’apprendre à l’habiter autrement.
Comparer n’est pas nécessairement jalouser. Comparer peut être une manière de se situer, de s’inspirer, de se mettre en mouvement.
La question n’est donc pas : comment cesser de se comparer ? mais plutôt : que faisons-nous de ce qui émerge en nous, lorsque la comparaison apparaît ?
6. L’argent comme miroir intérieur
L’argent ne parle pas tant de ce que nous avons, il parle de ce que nous croyons valoir. Et derrière cette croyance, il parle de nos blessures, de nos peurs, de nos fidélités invisibles.
Lorsque l’argent entre en scène — qu’il s’agisse d’un salaire, d’une prime, d’un tarif ou d’une négociation — il convoque en nous tout un monde intérieur. Un monde souvent confus, où se croisent la peur de manquer, le désir de reconnaissance, le besoin de sécurité, la crainte de perdre sa place.
Dans ce théâtre intime, l’argent agit comme un révélateur. Il nous montre nos attachements, nos attentes, nos jugements — parfois bien au-delà du seul sujet financier. Il éclaire ce qui en nous cherche à être vu, entendu, reconnu.
Se confronter à son rapport à l’argent, ce n’est pas simplement chercher à mieux gérer ses finances. C’est oser descendre à la racine de certaines de nos constructions les plus profondes.
Pourquoi ressentons-nous de la gêne à parler de ce que nous gagnons ? Pourquoi nous comparons-nous si spontanément aux autres ? Pourquoi certains montants nous semblent-ils « trop » ou « pas assez », indépendamment de toute logique objective ?
Parce que l’argent, avant d’être une unité d’échange, est un langage émotionnel et symbolique. Il est un territoire où se croisent nos désirs d’appartenance et notre besoin d’autonomie, nos fidélités familiales et nos rêves d’émancipation.
Et ce que nous projetons sur l’argent — rareté, injustice, liberté, pouvoir — ne dit peut-être pas tant quelque chose de l’argent lui-même… que de notre propre manière d’être au monde.
Je vous en parle dans l’épisode de Podcast « Oser parler d’argent ».
7. L’argent, fondement vivant de nos civilisations
Avant l’invention de l’argent, les échanges humains étaient contraints par le troc. Un mode d’échange direct, limité par une exigence lourde : pour qu’une transaction soit possible, il fallait que les besoins de chacun coïncident au même moment.
L’apparition de l’argent a bouleversé cette logique. En instaurant un intermédiaire symbolique, reconnu par tous les membres d’une société sans avoir de valeur intrinsèque, l’humanité a ouvert un nouvel espace : celui du commerce à grande échelle, celui de la spécialisation des talents, celui de la circulation fluide des biens et des services.
Yuval Noah Harari, dans Sapiens, rappelle que l’argent est peut-être la plus universelle des croyances humaines. Un billet de cinquante euros n’a aucune valeur en soi. Il ne se mange pas, ne chauffe pas, ne protège de rien. Il vaut cinquante euros uniquement parce que nous croyons collectivement qu’il le vaut — et parce que nous avons confiance que d’autres y croient aussi.
C’est la reconnaissance implicite que nous appartenons à un monde tissé de promesses invisibles, où la parole donnée — et crue — suffit à faire circuler la valeur.
Le mot confiance vient du latin cum fidere, qui signifie « avoir foi avec ». À travers l’argent, ce n’est pas simplement un bien ou un service que nous échangeons. C’est une part de foi commune.
Ainsi, l’argent, loin d’être un mal moderne, est à son origine un acte spirituel. Un pont jeté entre des volontés humaines diverses, un canal pour la rencontre et l’interdépendance.
Se rappeler cela, c’est retrouver une vision belle et haute de l’argent : non pas comme une force corruptrice, mais comme un souffle de confiance partagée, une œuvre collective de reliance au sein de la complexité humaine.
Conclusion — Vers une réconciliation intérieure
Parler d’argent, ce n’est pas seulement parler de ressources ou de justice. C’est parler de confiance, de foi partagée, de notre capacité à créer ensemble un monde habitable.
Sous les tensions, les jalousies, les crispations apparentes, l’argent révèle autre chose :
- notre besoin d’être reconnus,
- notre désir d’appartenir,
- notre crainte d’être oubliés.
Il nous montre nos blessures, mais aussi notre puissance de reliance. Il nous invite à sortir du fantasme d’un système parfaitement juste, pour entrer dans une attention plus fine, plus vivante, à ce qui nous lie les uns aux autres.
Repenser notre rapport à l’argent, ce n’est pas abolir la comparaison, nier les écarts ou décréter l’égalité parfaite. C’est accepter d’habiter, avec lucidité et avec grâce, le champ mouvant de nos besoins, de nos espérances et de nos responsabilités.
C’est reconnaître que la valeur ne se mesure pas seulement en heures ou en chiffres, mais aussi en courage, en présence, en fidélité silencieuse à ce qui nous dépasse.
Et si l’argent, plutôt que d’être un sujet honteux ou douloureux, redevenait ce qu’il fut peut-être à son origine : un signe humble et puissant de notre capacité à faire confiance, à croire ensemble, à tisser dans l’invisible une œuvre commune ?

Aliocha Iordanoff
Découvrir d’autres articles de l’auteur !
À lire aussi .
L’Holacratie a-t-elle des angles morts ?
Des lacunes vers la plénitude Un article de Dennis Wittrock publié le 13 juillet 2017 sur Medium, traduit par Aliocha Iordanoff. Les environnements économiques en mutation rapide favorisent l’agilité organisationnelle, rendue possible par une prise de décision...
*En quoi la citoyenneté est au cœur de l’autogouvernance ?
Article original, How Citizenship is at the heart of self-governance écrit par Diederick Janse – 17 mai 2023Traduit par Aliocha Iordanoff - 03 novembre 2025Je pratique passionnément l’auto-gouvernance depuis plus de quinze ans. Je la définis comme le fait de...
*Et si on rendait les entretiens 360° vraiment utiles ?
Chez Sémawé, on aime les processus et les outils… quand ils servent la relation plutôt que de l’abîmer. Et s’il y a bien un outil qui mérite d’être revisité, c’est celui de l’entretien 360°.Trop souvent vécu comme un bilan d’image — parfois cruel, parfois inutile — le...